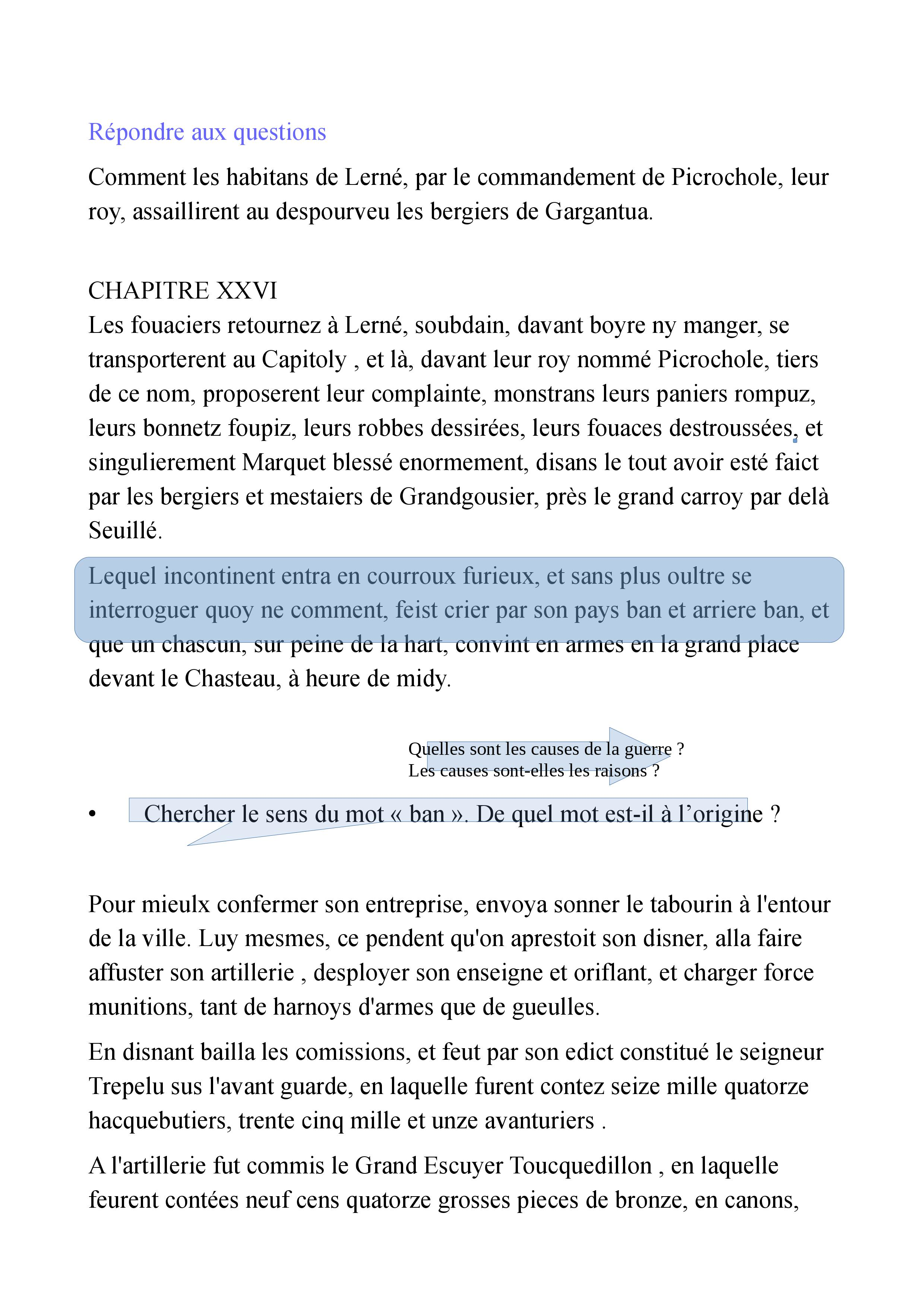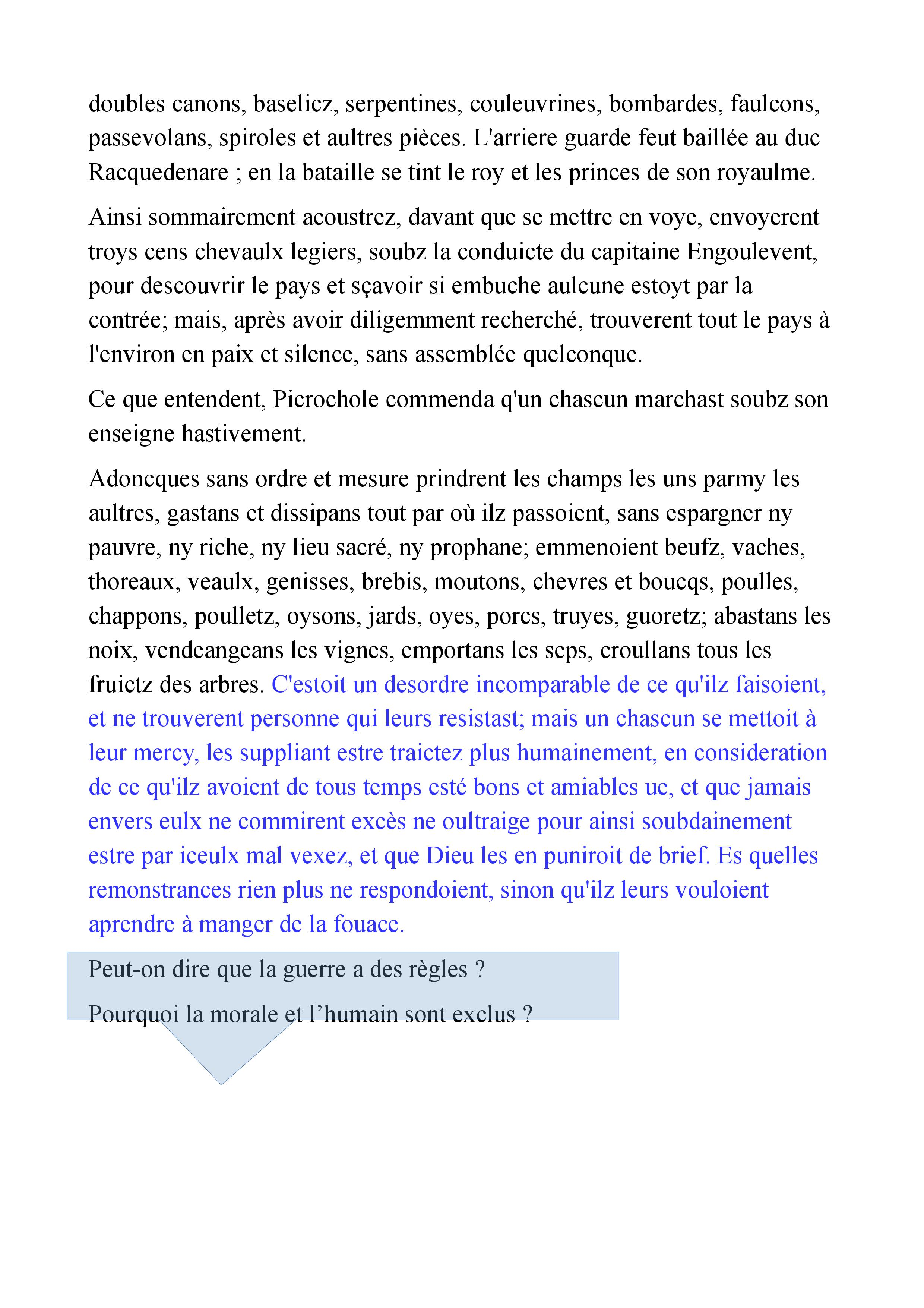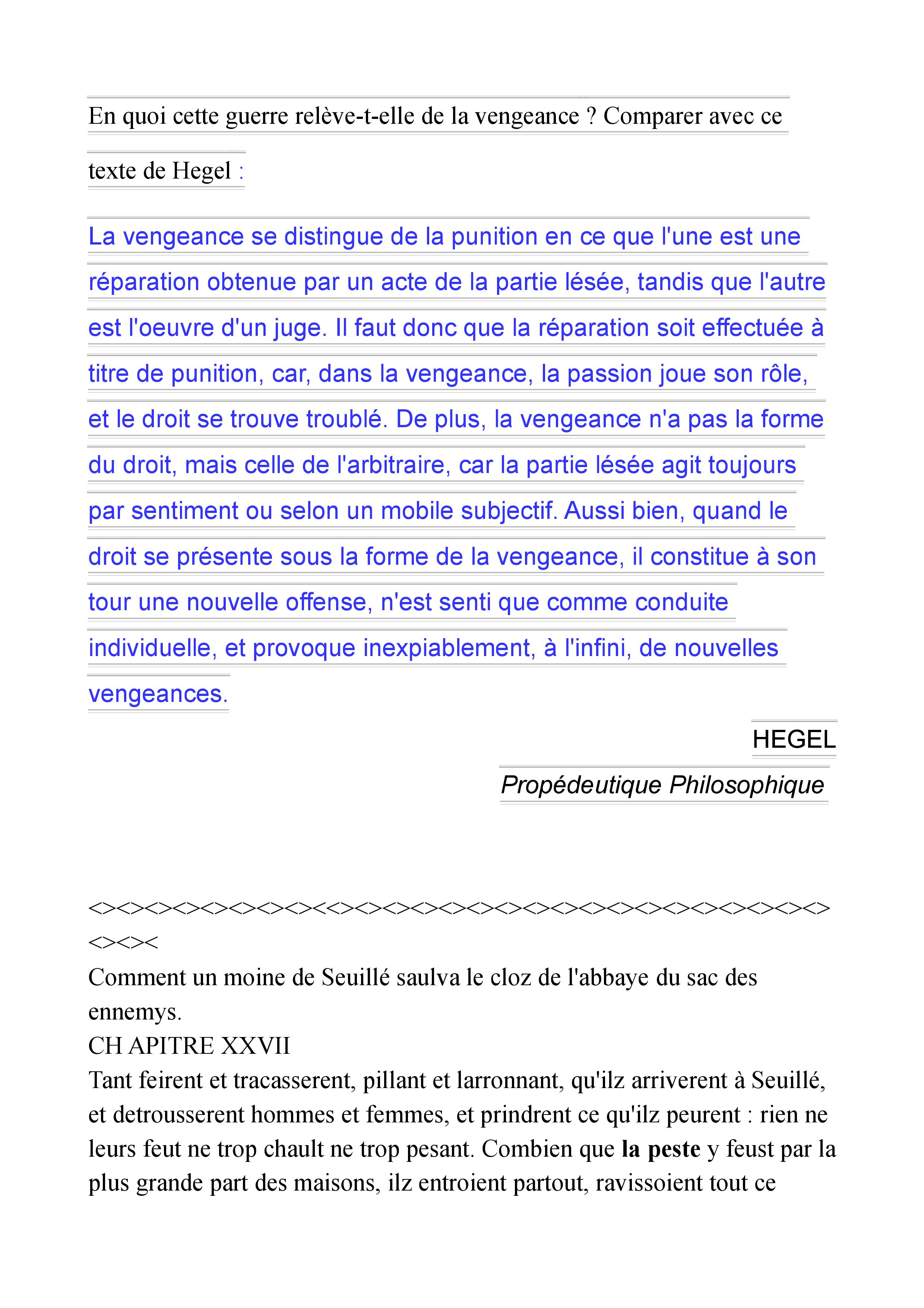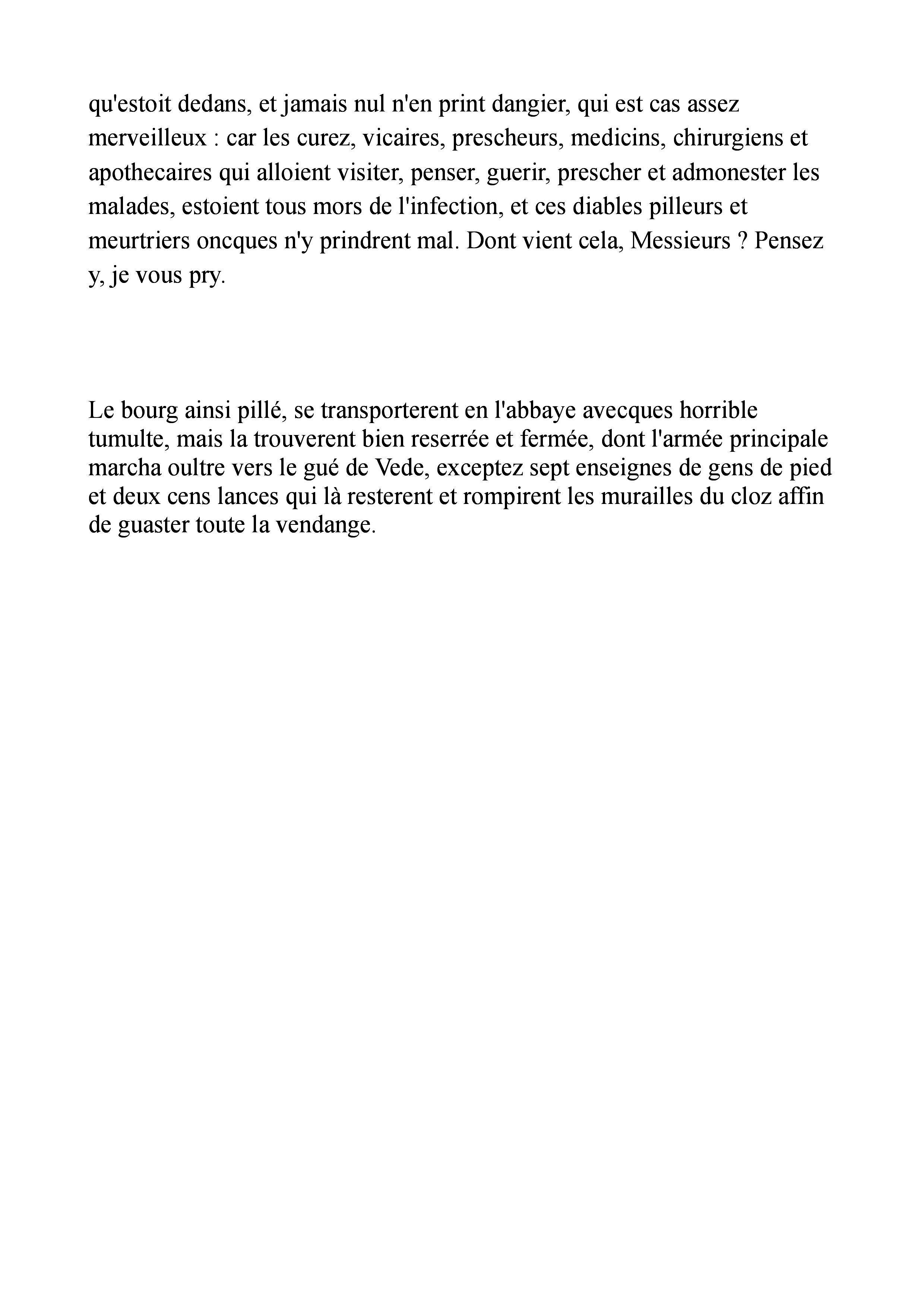(Maryse Emel)
En préambule : les exercices sont exemplaires et nullement imitables
1. La guerre : introduction
- Sources
Objectif : Usage de documents pour construire une problématique philosophique
1.1. Dire la guerre
- Lire ce texte de Jean-Claude Guillebaud Journaliste (source)
On songe parfois qu'il existe des gens pour qui l'appareil médiatique (radio, télé, etc. ) constitue le seul lien avec le monde. Mettons les personnes âgées, les reclus ou les malades : tous ceux qu'il faut imaginer attentifs au flot cascadant des nouvelles et sensibles aux plus petites inflexions verbales d'untel. Comment donc ces anonymes, qui ne savent pas grand-chose des configurations tribales régissant le "politico-médiatique", perçoivent-ils ces discours sur la guerre, devenus surabondants ? Discours des intellectuels, bien sûr, mais aussi des experts, analystes ou stratèges dont on finit par connaître, à force, les tics, les préjugés et les idées fixes. Avec un minimum d'attention, on peut établir ce qu'on pourrait appeler une typologie du parler guerrier. On apprend à classer ces voix devenues familières en quelques catégories identifiables, lesquelles, précisons-le, ne recouvrent pas forcément les opinions sur le fond. Il existe une façon haïssable d'appeler à l'engagement du combat et - quelquefois - une authentique probité dans la circonspection non violente. Mais cela peut jouer dans l'autre sens.
Du côté des intellectuels soutenant ou réclamant des offensives occidentales en Syrie (ils sont les plus nombreux), on distingue vite les va-t-en-guerre des humanistes. Les premiers déclament leur point de vue avec tant de fatuité qu'on se sent un peu gêné de penser parfois comme eux. Le ton est venu tuer le contenu. La flatulence théâtrale, comme toujours, a corrompu l'éloquence. On soupçonne ceux-là de tutoyer la tragédie pour se pousser du col. Ce sont des guerriers de l'arrière qui, à bonne distance du front, frémissent de se juger si courageux. Ils se rêvent en capitaines de parachutistes ou membres des forces spéciales.
On pense, bien sûr, aux intellectuels français "néoconservateurs" qui, en 2003, encouragèrent l'offensive américaine en Syrie, celle qui précipita le Proche-Orient dans un enfer dont il n'est toujours pas sorti treize ans après. Ce sont les mêmes qui dénoncent aujourd'hui la prétendue irresponsabilité occidentale, coupable d'après eux d'avoir laissé le champ libre à Poutine. On les entend s'apitoyer sur tous ces malheurs, un œil sur le micro ou sur la caméra. Les ai-je bien défendus ces civils d'Alep ?
On s'épargnera, ici, de citer des noms. Mais les prescripteurs trop contents d'eux-mêmes existent aussi dans l'autre camp. Ceux-là font profession de réalisme avec une lucidité funèbre. Ils pleurent sur les impérities passées et les désastres à venir avec je ne sais quelle jubilation crépusculaire. Si la catastrophe d'une guerre perdue leur donnait raison, on se demande s'ils n'en tireraient pas une obscure, une inavouable satisfaction rétrospective. Moralisateurs eux aussi, ils tirent à vue sur leurs jumeaux de l'autre camp et fulminent volontiers contre ce qu'ils appellent les "incompétents". On devine l'angoisse du citoyen lambda à l'idée que l'urgence lui fait obligation (du moins le croit-il) de choisir entre l'une ou l'autre de ces éloquences. Le propre des tragédies militaires, c'est qu'elles ne laissent qu'une alternative : d'un côté ou de l'autre. Les temps de guerre, c'est bien connu, congédient l'intelligence et favorisent les inquisiteurs de toute obédience. Nous voilà contraints de choisir entre deux catégories de bagou ?
C'est parce qu'il est habité par ce désarroi - ou cet agacement - que l'usager des médias dresse l'oreille quand, du fatras des ondes ou des images, surgit inopinément une parole plus authentique. Et celle-là, on l'identifie à la seconde. Elle suscite un respect instinctif et, serait-on tenté de dire, une confiance de principe. A quoi se reconnaît-elle ? C'est assez simple : une équanimité dans l'argumentation ; une attention modeste ; une façon de ne pas s'imaginer qu'on a la science infuse et de parler sans guetter son reflet dans une glace. Suggérons quelques noms à propos de l'actualité récente : Rony Brauman, Gérard Chaliand, Alain Frachon, Isabelle de Gaulmyn, Jean-Dominique Merchet. Et d'autres… Cette raison gardée dans la tempête et cette conscience de la complexité des situations n'excluent pas la fermeté d'un point de vue. Mais, du coup, ce dernier n'a pas besoin d'être théâtral. Au contraire. Ces commentateurs d'un autre type, même peu nombreux, sont comme ces amers repérables sur la côte qui aident les navigateurs à tenir le cap. On ne saluera jamais assez la présence d'une minorité de ces témoins raisonnables dans ces moments où la parole est humiliée par le bavardage…
- Dire ou bavarder
- Quelle distinction établit cet article? Pourquoi?
- En quoi cette distinction permet-elle de mettre en place une problématique?
Expliquer : Cette raison gardée dans la tempête et cette conscience de la complexité des situations n'excluent pas la fermeté d'un point de vue. Mais, du coup, ce dernier n'a pas besoin d'être théâtral. Au contraire. Ces commentateurs d'un autre type, même peu nombreux, sont comme ces amers repérables sur la côte qui aident les navigateurs à tenir le cap. On ne saluera jamais assez la présence d'une minorité de ces témoins raisonnables dans ces moments où la parole est humiliée par le bavardage
Chercher dans cette base de données un texte philosophique sur le bavardage à expliquer
En cliquant sur le numéro de la ressource, elle s'affichera| id | ressource | auteur | nature |
|---|---|---|---|
2304 | parler pour ne rien dire | Alain | sujet-texte |
1820 | Rapport à autrui | Alain | sujet-texte |
5948 | Heidegger | texte | |
5949 | Le bavardage | La Bruyère | texte |
5951 | mirlitonnades (1976-1978) | Beckett | texte |
Ambiguïté du mot "guerre"
Analyse du mot
définir et distinguer la guerre
- du massacre
- du conflit
- de la violence
- de la force
- de la puissance
- du brigandage
- montrer que la notion de guerre présente des sens qui peuvent être contradictoires
- la paix est-elle le contraire de la guerre?
1.2.1. Goya ou le refus du romantisme

Francisco de Goya y Lucientes
(1746 Fuendetodos - 1828 Bordeaux) Titre Série Les Désastres de la guerre. Quel courage ! Chronologie 1810-1820 Technique Eau-forte, aquatinte, burin et pointe sèche Dimensions H. 0,15 ; L. 0,20 m Statut administratif Don Amis des musées de Castres en 1980 Numéro d'inventaire 80-1-7 Au cours du premier siège de Saragosse, juchée sur des cadavres, une frêle jeune femme du nom d'Agustina Domenech, passée à la postérité sous le nom d'Agustina d'Aragon, fait feu sur les français avec une énorme pièce d'artillerie.
- en quoi cette oeuvre est le contraire d'une lecture "romantique" de la guerre?
- expliquer le choix du noir et blanc
- pourquoi un personnage féminin représente la guerre et la mort? Que symbolise traditionnellement la femme?
1.2.2. Comparer avec le mythe de Jeanne d'Arc, aboutissement de plusieurs mythes
- Les ancêtres : d'autres héroïnes guerrières

Pour trouver des héroïnes guerrières, il faut remonter au mythe d’origine, à la guerre de Troie en particulier, au cours de laquelle l’Amazone Penthésilée joue un rôle très important. Son rôle de guerrière est lié à la nécessité, à l’absence d’hommes dans un contexte de guerre. Elle apparaît durant la guerre de Troie. Son intervention se situe après la mort d’Hector, et son échec rendra inéluctable l’incendie de la cité. À la tête de son armée, l’Amazone se rend à Troie, attirée par la renommée d’Hector. À l’annonce de sa mort, elle décide de le venger en affrontant les principaux chefs grecs. Elle est tuée par Achille, qui pleure sa mort en admirant le corps inerte de la reine des Amazones. Ces guerrières, descendantes du dieu de la Guerre Arès, belles et courageuses, n’ont peur de rien, coupent leur sein droit pour mieux tirer à l’arc, marquant ainsi leur émancipation et leur refus de l’autorité des hommes. Pour assurer leur descendance, elles s’unissent cependant une fois par an aux hommes des peuplades voisines.
- Le vêtement et les armes de Jeanne : une symbolique
L’habit chevaleresque n’était pas qu’un vêtement ; il symbolisait toute une série de vertus inséparables de l’honneur masculin. Le chevalier se vêtait prioritairement de blanc (car il devait tenir son corps et son âme en pureté) et de rouge (car il acceptait de verser son sang pour défendre la Terre sainte, protéger la veuve et l’orphelin). • Épée en forme de croix : ses tranchants signifiaient symboliquement loyauté et rectitude. • Heaume (casque) : protège des péchés et des tentations extérieures. • Haubert (cotte de mailles) : symbole du courage à déployer contre les vices et contre les ennemis. Ces vertus symbolisées par les différentes armes n’étaient pas accessibles aux femmes, qui ne pouvaient pas être adoubées. Les personnages de guerrières apparaissent dans la littérature au milieu du xive siècle, mais l’idée de la femme participant à la guerre n’est pas du tout ancrée dans les mentalités. «L’apparition de Jeanne suscita chez tous l’étonnement et la curiosité, voire chez certains le refus devant le scandale qui menaçait l’ordre des choses ; de plus, Jeanne ne se contenta pas d’être une combattante. Dès le 22 mars 1429, elle proclama : “Je suis chef de guerre.” » (ibid.) '''L’accession de la femme au statut de guerrière passe par l’appropriation des valeurs masculines.''' « La masculinisation peut être brutale ou précédée d’un espace-temps qui joue le rôle d’un sas. L’héroïne n’y est pas encore homme et plus tout à fait femme. Pour devenir chevalier, il faut de la compétence et beaucoup d’entraînement» (Colette Beaune, op. cit., p. 167). Selon le théologien Berruyer, cité par Colette Beaune : « Le sexe féminin est par nature déficient en raison, il a le corps mou, il est incapable de supporter la fatigue ; timide, il tremble comme une feuille au vent devant les attaques ennemies ; en temps normal, la guerre oppose des hommes d’expérience. » Voilà qu’une fille a porté l’étendard et la lance, disposé des armées, supporté la fatigue des camps. Sans intervention d’ordre divin, il n’y a là qu’orgueil et présomption.
- Jeanne d'Arc et Judith

Judith décapitant Holopherne Caravage
Les théologiens, pour donner un statut à Jeanne et lui redonner une place dans un ordre (social, voire cosmologique) qu’elle a bousculé, vont mettre en avant la volonté divine, reléguant au second plan l’individu et plus loin encore la femme. Par une sorte de renversement, sa qualité de femme devient au contraire une preuve plus éclatante de la puissance de l’action divine. « Mais Dieu peut tout et sa Victoire est nettement plus visible s’il agit par l’intermédiaire des femmes, des enfants et des humbles. Les théologiens s’appuyèrent donc non sur les capacités des filles, mais sur celle de Dieu et bâtirent à Jeanne d’Arc un statut d’exception, sans conséquences sur le statut des autres femmes ; Dieu détenteur des règles pouvait les changer ; Il l’avait fait autrefois en envoyant Judith, Esther ou Déborah sauver le peuple élu. Il pouvait le refaire » (Colette Beaune, op. cit., p. 179).
Une des premières représentations de Jeanne consiste en un croquis de Clément de Fauquemberge en mai 1429, où l’on peut voir Jeanne les cheveux libres, brandissant l’étendard, une épée au côté ; il s’agit d’un croquis imaginaire. L’étendard disparaît progressivement au profit de l’épée et de la hallebarde. Mais Jeanne n’est pas la seule à porter une bannière : lors de la bataille du pont de Comines (7 novembre 1382), les Flamands avaient mis en scène une prophétesse portant la bannière de saint Georges, signe de sa participation au combat. À Rouen, on peut lire la légende suivante, qui accompagne un tableau du xviie siècle : « Jeanne d’Arc du Lis, pucelle d’Orléans, amazone de France, inspirée de Dieu en sa patrie, pays barrois, pris (sic) les armes, et comme une autre Judith, coupa la tête à l’Holopherne anglais, chassa ses armées, sauva le royaume de France, et rétably (sic) le roy Charles 7e en son trône, 1429. » Judith et Jeanne sont rapprochées pour leur caractère séducteur, leur jeunesse et leur virginité. L’évolution de l’image de Jeanne montre la difficulté pour les gens du Moyen Âge de conceptualiser cette image, et leur besoin de se référer à un exemple connu pour faciliter la compréhension de l’événement. Mais elle explique aussi qu’on aboutisse finalement à une image ambivalente. On a préféré plaquer sur l’image de Jeanne celle de la jeune séductrice plutôt que celle de la vieille prophétesse. Jeanne et Déborah : une comparaison fréquente au xve siècle Prophétesses et guerrières, l’une et l’autre exercent un office viril : juge pour Déborah, seule femme dans la Bible qui accompagne une armée et porte une bannière, et chef de guerre pour Jeanne. Toutes deux prédisent et obtiennent la victoire de leur peuple, portent l’armure et l’étendard, mais Jeanne, adolescente vierge, s’éloigne rapidement de la veuve Déborah pour se rapprocher de la jeune Judith. La comparaison avec cette dernière est assez tardive, rare avant 1450. Toutefois dès 1431, les juges avaient opéré un rapprochement en s’appuyant sur l’exécution de Franquet d’Arras, décapité sur l’ordre de la Pucelle. Jean Bréhal, inquisiteur de France qui a rouvert le procès de Jeanne d’Arc, osa un parallèle entre Jeanne et Judith ; Jeanne aurait dit, comme Judith, « fais seigneur qu’il soit amputé de son orgueil par sa propre épée ».
Sources : Olivier Bouzy, Images de Jeanne d’Arc, in Jean Maurice et Daniel Couty (dir.), Actes du colloque de Rouen de mai 1999, PUF, 2000.
1.3.1. La Guerre de Troie Homère
| Une épopée dramatique |
|---|
| Plus qu’un récit de la guerre de Troie, l’Iliade est l’histoire de la colère d’Achille, de sa rancune qui le maintient hors du combat jusqu’à ce que la mort de son compagnon Patrocle le jette à nouveau dans la guerre, par vengeance. Ce qui fait dire à Jacqueline de Romilly que "l’Iliade" ressortit plus au genre dramatique qu’au genre épique » (Hector, Le Livre de poche, p. 44). L’histoire de Troie et de tous les héros de la guerre est contée par de nombreux autres écrits, et a fait l’objet d’une abondante représentation dans tous les domaines artistiques. Ainsi en connaît-on les principaux épisodes sans avoir lu l’Iliade. Homère prend la guerre dans sa dixième et dernière année, sans l’amener à son terme, la chute de Troie. Il décrit – sans prendre parti pour l’un ou l’autre camp – quelques journées de combat dans la plaine etdevant les murs de la ville, l’affrontement entre Achille et Hector, qui en constitue l’apogée, et il clôt son récit par les funérailles d’Hector.L’intervention incessante des dieux dans le cours du combat, les relations étroites entre les Immortels et les héros imprègnent le récit homérique. La société des dieux ressemble à celle des hommes : ils discutent et se querellent, mais le dernier mot revient toujours à Zeus, le « père des dieux », comme à Agamemnon, « protecteur de son peuple ». La réalité historique de cette guerre, sa datation, la situation géographique de Troie, l’origine des peuples en présence, l’existence des héros ont soulevé des questions et suscité des recherches archéologiques et des débats passionnés, sans pour autant apporter de réponses définitives. |
| Rédigé vers 1165, ce poème lon gde plus de 30 000 vers s’inspire de deux résumés tardifs de l’ œuvre d’Homère écrits par Dictys de Crète et Darès le Phrygien respectivement aux ive et ve-vie siècles. |
| Chante, déesse, la colère d’Achille, le fils de Pélée ; détestable colère, qui aux Achéens valut des souffrances sans nombre et jeta en pâture à Hadès tant d’âmes fières de héros, tandis que de ces héros mêmes elle faisait la proie des chiens et de tous les oiseaux du ciel – pour l’achèvement du dessein de Zeus. Pars du jour où une querelle tout d’abord divisa le fils d’Atrée, protecteur de son peuple, et le divin Achille. Iliade, I, 1-7, trad. Paul Mazon |
1.4.2. Le sens politique de la peste : cliquer pour lire le texte Surveiller et punir. Michel Foucault
1.4.3. La symbolique de l'épée dans les textes médiévaux : l'esthétisation de la guerre
Ambiguïté de l'esthétisation Jusqu'où peut-on aller?
L’épée est un des rares objets qui ait acquis dès son origine une dimension symbolique si forte et qui ait été propulsé dans l’univers mythique et légendaire.
Dans ce maillage de sens dense et complexe, la littérature tient un rôle fondamental car elle est un des ressorts de la constitution et de la transmission de l’imaginaire collectif qui entoure l’épée. Les auteurs mé- diévaux ont trouvé dans l’épée un rouage dynamique et dramatique sans pareil, depuis la simple arme du chevalier, jusqu’à l’arme merveilleuse du héros. Ainsi, l’épée littéraire prend, dans plusieurs registres, épiques, merveilleux ou courtois, une forme et une fonction différentes.
- Scènes de bataille :
Quand Roland voit qu’il y aura bataille, il devient plus féroce que lion ou léopard. Il appelle les Français et dit à Olivier : « Seigneur, mon compagnon, mon ami, ne parlez plus ainsi ! L’empereur, qui nous a laissé les Français, en a choisi vingt mille qui sont tels à son avis que pas un n’est un lâche. Pour son seigneur on doit subir de grands maux, endurer de grands froids et de fortes chaleurs, on doit perdre de son sang et de sa chair. Frappe de ta lance et moi de Durandal, ma bonne épée que le roi me donna. Si je meurs, celui qui l’aura pourra dire que ce fut l’épée d’un noble vassal. »
La bataille fait rage et devient générale. Le comte Roland ne fuit pas le danger. Il frappe de l’épieu tant que résiste la hampe ; après quinze coups il l’a brisée et détruite Il dégaine Durandal, sa bonne épée, il éperonne son cheval et va frapper Chernuble, il lui brise le casque où brillent des escarboucles, lui tranche la tête et la chevelure, lui tranche les yeux et le visage, et la cuirasse blanche aux fines mailles, et tout le corps jusqu’à l’enfourchure. À travers la selle plaquée d’or, l’épée atteint le corps du cheval, lui tranche l’échine sans chercher la jointure, et il l’abat raide mort dans le pré sur l’herbe drue. Puis il lui dit : « Canaille, pour votre malheur vous êtes venu ici ! De Mahomet vous n’aurez jamais d’aide. Un truand comme vous ne gagnera pas aujourd’hui la bataille. » [...]
Et Olivier chevauche parmi la mêlée de sa lance brisée, il n’a plus qu’un tronçon. Il va frapper un païen, Malsaron, lui brise son bouclier couvert d’or et de fleurs, lui fait de la tête sauter les deux yeux et la cervelle lui tombe jusqu’aux pieds. Il l’abat mort avec sept cents des leurs. Puis il a tué Turgis et Esturgot. Sa lance se brise et se fend jusqu’aux poings. Roland lui dit : « Compagnon, que faites vous ? Dans une telle bataille, je ne veux pas d’un bâton ; le fer et l’acier doivent prévaloir. Où est donc votre épée qui se nomme Hauteclaire ? La poignée en est d’or, le pommeau de cristal. — Je n’ai pu la tirer, lui répond Olivier, car, à frapper, j’avais tant de besogne ! » Sire Olivier a tiré sa bonne épée que son compagnon Roland lui a tant demandée, et il l’a brandie en vrai chevalier. Il frappe un païen, Justin de Valferrée, il lui partage en deux toute la tête, il lui tranche le corps et la brogne safrée, la bonne selle aux gemmes serties d’or, et du cheval il a tranché l’échine. Il les abat morts devant lui dans le pré. Roland lui dit : « Je vous reconnais, frère. Pour de tels coups l’empereur nous aime. » De toutes parts, on a crié « Monjoie ». […] La bataille est merveilleuse et pénible. Olivier et Roland frappent à tour de bras, l’archevêque rend plus de mille coups, les douze pairs ne perdent pas leur temps, et les Français frappent tous ensemble. Les païens meurent par centaines et milliers : qui ne fuit pas, contre la mort n’a pas de recours ; bon gré mal gré, il y laisse sa vie. Les Français perdent leurs meilleurs défenseurs ; ils ne reverront pas leurs pères ni leurs parents, ni Charlemagne qui aux cols les attend. En France se déchaîne une prodigieuse tourmente, des orages de tonnerre et de vent, de pluie et de grêle, hors de toute mesure ; la foudre tombe à coups redoublés dans le fracas d’un tremblement de terre : de Saint Michel du Péril jusqu’à Xanten, de Besançon jusqu’au port de Wissant, il n’est pas de maison dont un mur ne se fende En plein midi règnent de sombres ténèbres : il n’y a de clarté que si le ciel se fend. Personne ne le voit sans être épouvanté. Plusieurs disent : « C’est la consommation des siècles, la fin du monde à quoi nous assistons. » Ils ne savent pas, ils ne disent rien de vrai : c’est le grand deuil pour la mort de Roland.
- Le corps à corps burlesque : L’Histoire du Chevalier Zifar
Dans ce roman espagnol du XIVe? siècle, le héros allie les qualités d’un chevalier hors pair au maniement des armes à des côtés burlesques ou comiques. Le combat dans lequel le fils d’un félon est pourfendu d’un coup d’épée illustre cette dualité. La scène du chevalier noir de Monty Python : Sacré Graal (1975), outre une certaine similitude avec la précédente, démontre que l’efficacité d’un tel rouage narratif demeure invariante au fil des siècles. [...] Là-dessus, il mit la main à l’épée et se couvrit de son écu. Garfin fondit sur lui et porta, d’un mouvement du poignet, un coup de lance sur son bouclier, de sorte qu’elle le lui transperça et s’en brisa, mais sans pour autant atteindre le comte qui tenait son écu écarté du corps. Le comte asséna un grand coup de son épée au cheval de Garfin, l’arrêtant net. Voyant cela, Garfin sauta de sa monture et sortit son épée. Il courut contre le comte et lui asséna un coup si puissant qu’il lui sectionna la sangle de l’écu. Musée de Cluny • L’épée – Usages, mythes et symboles • 23 Le comte frappa Garfin, fendant son bouclier de haut en bas et lui entaillant quelque peu le bras. « Allons, chevalier s’exclama le comte. Votre avantage est bien mince, bien que vous soyez armé et moi pas ! — Mais la loyauté est bien plus grande que la félonie, lui renvoya Garfin, et l’écart est fort grand entre votre déloyauté et ma fidélité ! — Que voulez-vous dire ? s’étonna le comte. — Eh bien, vous avez manqué de droiture envers le roi de Menton, mon seigneur, vous avez forfait au service que vous lui deviez, et alors que vous êtes son vassal, sans rompre le lien qui vous attache à lui et sans qu’il y ait donné motif, vous courez ses terres ! C’est pourquoi vous mourrez ici-même, comme tout traître qui se départit de la fidélité et de la loyauté ! — Tu mens ! s’écria le comte. Tu n’es qu’un vil chevalier J’ai envoyé l’un des miens lui donner mon congé, et on lui a baisé la main en mon nom ; à partir de là, il n’a plus été mon seigneur, ni moi son vassal ! — Ce n’est guère une excuse de bon chevalier que de donner congé à son roi et ensuite de courir ses terres alors que celui-ci ne lui a fait aucun tort ! rétorqua Garfin. Je crois que vous feriez mieux de vous rendre ; je vous mènerai au roi et lui demanderai de vous accorder sa grâce ! — Je vous assure, répondit le comte, que vous ne me ferez pas prisonnier si vous ne montrez pas plus de force ! — Comment ? dit Garfin. Vous pensez que je suis vraiment épuisé ? Je crois en l’aide de Dieu, et vous connaîtrez ma force avant que nous partions d’ici ! » Ils avancèrent l’un vers l’autre, faisant tinter leurs épées, car c’était d’excellents escrimeurs. Ils portaient de violents coups sur leurs écus, les faisant voler en éclats. Le comte Nason frappa d’estoc et toucha Garfin à la joue, lui infligeant une sévère blessure ; il lui dit alors : « Eh bien chevalier, il aurait été préférable pour vous de vous satisfaire de la victoire que Dieu vous avait donnée dans le camp que de tout vouloir : on dit bien de qui trop embrasse, mal étreint ! — Quoi ? répondit Garfin. Vous pensez vous en être tiré par la grâce de cette estafilade ? Je ne crois pas que Dieu acceptera que le diable, défenseur du mensonge, l’emporte sur celui qui défend la vérité : » Le comte poursuivit : « Non, chat échaudé craint l’eau froide. Vous voyez bien que si vous ne me poursuiviez pas avec autant d’acharnement, vous n’auriez pas cette entaille sur la joue. On dit bien que l’on peut suivre le loup, mais non pas le chercher ! Je crois que vous feriez mieux, dans votre intérêt, de retourner auprès des vôtres et de me laisser aller en paix ! » Le comte brandissait son épée, quand Garfin, en proie à une terrible fureur, lui envoya un violent coup, lui coupant la manche de son pourpoint matelassé et faisant, par la même occasion, voler à terre le bras et la main qui tenait l’épée. Le coup fut si brutal qu’il lui sectionna un grand morceau de la hanche, ainsi que les orteils, de sorte que le comte ne put rester debout et s’écroula sur le sol. « Allons, allons, monsieur le comte ! s’exclama Garfin, il eût mieux valu pour vous accepter volontiers d’être mon prisonnier que de rester ainsi, contre votre gré, manchot et boiteux. — Ô, maudit soit celui qui vous a donné une si grande force ! jura le comte, car vous n’étiez pas homme à me vaincre ni à me mettre en si piteux état ! — Vous blasphémez maintenant ? dit Garfin. Vous persistez dans votre erreur ? Elle vous a conduit ici pour que vous vous repentiez ! » […] Lorsque Roboam et les autres virent qu’il ramenait prisonnier le comte, il en remercièrent infiniment Dieu et se réjouirent grandement de voir que Garfin était vivant, bien qu’il fût vilainement blessé à la joue et que son visage eût gonflé. Mais on le soigna dans les règles de l’art, de sorte qu’il fut guéri en peu de jours, puis on consolida les plaies du comte.
- L’adieu du héros à son épée
La Chanson de Roland : la mort de Roland
Le lien affectif qui unit le héros à son épée est d’une nature extrêmement complexe. Au seuil de la mort, Roland refuse d’abandonner Durandal aux païens et tente de la briser. Dans une longue adresse à cette figure personnifiée, il relate les nombreux exploits accomplis grâce à elle et dresse le portrait d’une arme véritablement extraordinaire.
Roland sent qu’il a perdu la vue, il se redresse et fait tous ses efforts. Son visage a perdu sa couleur. Devant lui il y a une roche grise. Il y frappe dix coups, de chagrin et de dépit. L’acier grince, mais il ne se brise ni ne s’ébrèche. « Ah ! dit le comte, sainte Marie, aide moi ! Ah ! Durandal, ma bonne épée, quel malheur pour vous ! Puisque je suis perdu, de vous je perds la charge. Combien de batailles par vous j’ai remportées, combien j’ai conquis de terres immenses, que tient Charles, dont la barbe est chenue ! Ne soyez pas à quelqu’un qui fuit devant un autre ! Un valeureux vassal vous a longtemps tenue ; jamais il n’en sera de pareille à vous dans la sainte France. Roland frappe sur le bloc de sardoine. L’acier grince, mais il ne se brise ni ne s’ébrèche. Quand il voit qu’il ne peut la rompre, en lui même il commence à la plaindre : « Ah ! Durandal, comme tu es belle, claire, éclatante ! Comme au soleil tu brilles et flamboies ! Charles était dans les vallées de Maurienne quand Dieu, du ciel, lui fit savoir par son ange qu’il te donnât à un comte capitaine : alors il me la ceignit, le noble roi, le grand. Avec toi je lui conquis l’Anjou et la Bretagne, et lui conquis le Poitou et le Maine ; avec toi je lui conquis la libre Normandie, et lui conquis la Provence et l’Aquitaine et la Lombardie et toute la Romagne ; avec toi je lui conquis la Bavière et les Flandres et la Bourgogne et toute la Pologne, Constantinople dont il reçut l’hommage ; et sur la Saxe il règne en maître. Avec toi je lui conquis l’Écosse et l’Irlande et l’Angleterre qu’il appelait son domaine ; avec toi je lui conquis tant et tant de pays que tient Charles dont la barbe est blanche. Pour cette épée j’éprouve douleur et peine. Mieux vaut mourir que la laisser aux païens ! Dieu ! Père, ne laissez pas déshonorer la France ! » Roland frappe sur une pierre grise. Il en abat plus que je ne sais vous dire. L’épée grince, mais elle ne se rompt ni ne se brise. Vers le ciel elle a rebondi. Quand le comte voit qu’il ne la brisera pas, tout doucement il la plaint en lui même : « Ah ! Durandal, comme tu es belle et très sainte ! Dans ton pommeau d’or, il y a bien des reliques, une dent de saint Pierre et du sang de saint Basile et des cheveux de monseigneur saint Denis, et du vêtement de sainte Marie. Il n’est pas juste que des païens te possèdent : c’est par des chrétiens que tu dois être servie. Ne soyez pas à un homme capable de couardise ! J’aurai par vous conquis tant de terres immenses que tient Charles dont la barbe est fleurie ! Et l’empereur en est puissant et riche. » [...] Le comte Roland est étendu sous un pin. Vers l’Espagne il a tourné son visage. De bien des choses le souvenir lui revient, de tant de terres que le baron a conquises, de la douce France, des hommes de son lignage, de Charlemagne, son seigneur, qui l’a formé. Il ne peut s’empêcher de pleurer et de soupirer. Mais il ne veut pas s’oublier lui même. Il bat sa coulpe et demande pardon à Dieu : « Père véritable qui jamais ne mentis, toi qui ressuscitas saint Lazare et qui sauvas Daniel des lions, sauve mon âme de tous les périls pour les péchés qu’en ma vie j’ai commis ! » Il a offert à Dieu son gant droit, saint Gabriel de sa main l’a pris. Sur son bras il tenait sa tête inclinée ; les mains jointes, il est allé à sa fin. Dieu envoya son ange Chérubin et saint Michel du Péril ; et avec eux vint saint Gabriel. Ils emportent l’âme du comte en paradis
- L'épée de chasteté
Tristan et Iseut (Béroul, fin du XIIe? siècle) Tristan et Iseut se sont enfuis de la cour du roi Marc et se sont réfugiés dans la forêt du Morois, où ils vivent dans le dénuement le plus complet, loin de la rumeur du monde. Le roi Marc, toujours à leur recherche, finit par les retrouver et décide de les surprendre. Tout le rouage dramatique de cette célèbre scène repose sur l’ambiguïté symbolique que constitue l’épée de Tristan et qui conduit le roi Marc à un véritable contresens, salutaire pour les amants. […] Seigneurs, c’était un jour d’été, au temps où l’on moissonne, un peu après la Pentecôte, et les oiseaux à la rosée chantaient l’aube prochaine. Tristan sortit de la hutte, ceignit son épée, apprêta l’arc Qui-ne-faut et, seul, s’en fut chasser par le bois. Avant que descende le soir, une grande peine lui adviendra. Non, jamais amants ne s’aimèrent tant et ne l’expièrent si durement. Quand Tristan revint de la chasse, accablé par la lourde chaleur, il prit la reine entre ses bras. « Ami, où avez-vous été ? — Après un cerf qui m’a tout lassé. Vois, la sueur coule de mes membres, je voudrais me coucher et dormir. » Sous la loge de verts rameaux, jonchée d’herbes fraîches, Iseut s’étendit la première ; Tristan se coucha près d’elle et déposa son épée nue entre leurs corps. Pour leur bonheur, ils avaient gardé leurs vêtements. La reine avait au doigt l’anneau d’or aux belles émeraudes que Marc lui avait donné au jour des épousailles ; ses doigts étaient devenus si grêles que la bague y tenait à peine. Ils dormaient ainsi, l’un des bras de Tristan passé sous le cou de son amie, l’autre jeté sur son beau corps, étroitement embrassés ; leurs lèvres ne se touchaient point. Pas un souffle de brise, pas une feuille qui tremble. À travers le toit de feuillage, un rayon de soleil descendait sur le visage d’Iseut qui brillait comme un glaçon. Or, un forestier trouva dans le bois une place où les herbes étaient foulées ; la veille, les amants s’étaient couchés là ; mais il ne reconnut pas l’empreinte de leurs corps, suivit la trace et parvint à leur gîte. Il les vit qui dormaient, les reconnut et s’enfuit, craignant le réveil terrible de Tristan. Il s’enfuit jusqu’à Tintagel, à deux lieues de là, monta les degrés de la salle, et trouva le roi qui tenait ses plaids au milieu de ses vassaux assemblés. « Ami, que viens-tu quérir céans, hors d’haleine comme je te vois ? On dirait un valet de limiers qui a longtemps couru après les chiens. Veux-tu, toi aussi, nous demander raison de quelque tort ? Qui t’a chassé de ma forêt ? » Le forestier le prit à l’écart et, tout bas, lui dit : « J’ai vu la reine et Tristan. Ils dormaient, j’ai pris peur. — En quel lieu ? — Dans une hutte du Morois. Ils dorment aux bras l’un de l’autre. Viens tôt, si tu veux prendre ta vengeance. — Va m’attendre à l’entrée du bois, au pied de la Croix Rouge. Ne parle à nul homme de ce que tu as vu ; je te donnerai de l’or et de l’argent, tant que tu en voudras prendre. » Le forestier y va et s’assied sous la Croix Rouge. Maudit soit l’espion ! Mais il mourra honteusement, comme cette histoire vous le dira tout à l’heure. Le roi fit seller son cheval, ceignit son épée, et, sans nulle compagnie, s’échappa de la cité. Tout en chevauchant, seul, il se ressouvint de la nuit où il avait saisi son neveu : quelle tendresse avait alors montrée pour Tristan Iseut la Belle, au visage clair ! S’il les surprend, il châtiera ces grands péchés ; il se vengera de ceux qui l’ont honni… À la Croix Rouge, il trouva le forestier : « Va devant ; mène-moi vite et droit. » L’ombre noire des grands arbres les enveloppe. Le roi suit l’espion. Il se fie à son épée, qui jadis a frappé de beaux coups. Ah ! si Tristan s’éveille, l’un des deux, Dieu sait lequel ! restera mort sur la place. Enfin le forestier dit tout bas : « Roi, nous approchons. » Il lui tint l’étrier et lia les rênes du cheval aux branches d’un pommier vert. Ils approchè- rent encore, et soudain, dans une clairière ensoleillée, virent la hutte fleurie. Le roi délace son manteau aux attaches d’or fin, le rejette, et son beau corps apparaît. Il tire son épée hors de la gaine, et redit en son cœur qu’il veut mourir s’il ne les tue. Le forestier le suivait ; il lui fait signe de s’en retourner. Musée de Cluny • L’épée – Usages, mythes et symboles • 27 Il pénètre, seul, sous la hutte, l’épée nue, et la brandit… Ah ! quel deuil s’il assène ce coup ! Mais il remarqua que leurs bouches ne se touchaient pas et qu’une épée nue séparait leurs corps : « Dieu ! se dit-il, que vois-je ici ? Faut-il les tuer ? Depuis si longtemps qu’ils vivent en ce bois, s’ils s’aimaient de fol amour, auraient-ils placé cette épée entre eux ? Et chacun ne sait-il pas qu’une lame nue, qui sépare deux corps, est garante et gardienne de chasteté ? S’ils s’aimaient de fol amour, reposeraient-ils si purement ? Non, je ne les tuerai pas ; ce serait grand péché de les frapper ; et si j’éveillais ce dormeur et que l’un de nous deux fût tué, on en parlerait longtemps, et pour notre honte. Mais je ferai qu’à leur réveil ils sachent que je les ai trouvés endormis, que je n’ai pas voulu leur mort, et que Dieu les a pris en pitié. » Le soleil, traversant la hutte, brûlait la face blanche d’Iseut. Le roi prit ses gants parés d’hermine : « C’est elle, songeait-il, qui, naguère, me les apporta d’Irlande !… » Il les plaça dans le feuillage pour fermer le trou par où le rayon descendait ; puis il retira doucement la bague aux pierres d’émeraude qu’il avait donnée à la reine ; naguère il avait fallu forcer un peu pour la lui passer au doigt ; maintenant ses doigts étaient si grêles que la bague vint sans effort : à la place, le roi mit l’anneau dont Iseut, jadis, lui avait fait présent. Puis il enleva l’épée qui séparait les amants, celle-là même – il la reconnut – qui s’était ébréchée dans le crâne du Morholt, posa la sienne à la place, sortit de la loge, sauta en selle, et dit au forestier : « Fuis maintenant, et sauve ton corps, si tu peux ! »
- L’épée « périlleuse »
Lancelot ou le Chevalier à la charrette : Le Pont de l’épée (Chrétien de Troyes, fin du XIIe? siècle) Ce roman courtois relate la longue série d’épreuves que doit surmonter Lancelot afin de délivrer sa dame, la reine Guenièvre, prisonnière du roi Méléagant. Dernier obsctacle, le Pont de l’Épée résume à lui seul le lien symbolique ambigu qu’entretient l’épée entre Éros et Thanatos, l’amour et la mort. Il s’agit d’un pont constitué d’une longue épée tranchante, que le héros doit franchir au péril de sa vie, pour délivrer la femme qu’il aime, étape ultime de la métaphorisation de la conquête amoureuse. [...] Ce jour-là, dès la matinée ils ont chevauché jusqu’à la vesprée, sans trouver aventure. Vont cheminant le droit chemin. Comme le jour va déclinant, ils viennent au Pont de l’Epée. À l’entrée de ce pont terrible, ils mettent pied à terre. Ils voient l’onde félonesse rapide et bruyante, noire et épaisse, aussi laide et épouvantable que si ce fût fleuve du diable. Et si périlleuse et profonde qu’il n’est nulle créature au monde, si elle y tombait, qui ne soit perdue comme en la mer salée. Le pont qui la traverse n’est pareil à nul autre qui fut ni qui jamais sera. Non, jamais on ne trouvera si mauvais pont, si male planche. D’une épée fourbie et blanche, était fait le pont sur l’eau froide. L’épée était forte et roide et avait deux lances de long. Sur chaque rive était un tronc où l’épée était clofichée. Nulle crainte qu’elle se brise ou ploie. Et pourtant, il ne semble pas qu’elle puisse grand faix porter. Ce qui déconforterait les deux compagnons, c’est qu’ils croyaient voir deux lions ou deux léopards à chaque tête de ce pont, enchaîné à une grosse pierre. L’eau et le pont et les lions mettent les deux compagnons en une telle frayeur qu’ils tremblent de peur et disent au chevalier : « Sire, croyez le conseil que vous donnent vos yeux ! Il vous faut recevoir ! Ce pont est mal fait, mal joint et mal charpenté. Si vous ne vous en retournez maintenant, vous vous repentirez trop tard. Avant d’agir, il convient de délibérer. Imaginons que vous ayez passé ce pont – ce qui ne peut advenir, pas plus que de retenir les vents, de leur défendre de venter, d’empêcher les oiseaux de chanter ou de faire rentrer un homme dedans le ventre de sa mère et de faire qu’il en renaisse. Ce serait faire l’impossible comme de vider la mer. Comment pouvez-vous penser que ces deux lions forcenés enchaînés à ces pierres ne vont vous tuer puis sucer le sang de vos veines, manger votre chair, ronger vos os ? Nous nous sentons trop hardis rien que d’oser les regarder. Si vous ne vous en gardez point, ils vous occiront, sachez-le. Et les membres de votre corps ils vous rompront et arracheront. Jamais n’auront pitié de vous ! « Ayez donc pitié de vous-même et demeurez avec vos compagnons ! Vous auriez tort si, par votre faute et le sachant, vous vous mettiez en péril de mort ! » Le chevalier leur répondit en riant : « Seigneurs, je vous sais gré très vif de vous émouvoir ainsi pour moi. C’est preuve de cœurs amis et généreux. Je sais bien qu’en nulle guise, vous ne voudriez qu’il m’arrive malheur. J’ai telle foi, telle confiance en Dieu qu’il me protégera en tous lieux. Le pont ni cette eau je ne crains, non plus que cette terre dire. Je veux me mettre à l’aventure, me préparer à passer outre. Plutôt mourir que reculer ! » Lors, ils ne savent plus que dire, mais de pitié pleurent et soupirent. Et lui de passer le gouffre. Le mieux qu’il peut, il se prépare et – très étrange merveille ! – il désarme ses pieds, ses mains. Il se tenait bien sur l’épée qui était plus tranchante qu’une faux, les mains nues et les pieds déchaux, car il n’avait laissé aux pieds souliers, ni chausses, ni avanpiés. Mais il aimait mieux se meurtrir que choir du pont et se noyer dans l’eau dont il ne pourrait sortir. A grand douleur, comme il convient, il passe outre, et en grand détresse, mains, genoux et pieds il se blesse. Mais l’apaise et le guérit Amour qui le conduit et mène. Tout ce qu’il souffre lui est doux. Des mains, des pieds et des genoux, il fait tant qu’il parvient de l’autre côté. Alors il se souvient des deux lions qu’il croyait avoir vus quand il était sur l’autre rive. Il regarde tout autour de lui. N’y avait pas même un lézard qui pût donner à craindre. Il met sa main devant sa face, regarde son anneau et ne trouve aucun des deux lions qu’il croyait pourtant avoir vus. Il pense être déçu par un enchantement, car il n’y avait rien là qui vive.
- L’arme du suicide amoureux
La châtelaine de Vergy Trompée par son amant, la châtelaine de Vergy met fin à ses jours. Lorsqu’il découvre le corps sans vie de sa dame, l’infidèle, rongé par le remords et le désespoir, se suicide à son tour. Texte original (v. 882-900) À ces mots, le chevalier comprit que ses confidences au duc l’ont tuée ; son affliction est alors sans bornes ; « Hélas ! fait-il, mon doux amour, Vous la plus parfaite, la meilleure Qui fût jamais, vous la plus fidèle C’est moi, perfide, infidèle, Qui vous ai tuée ! Il eût été juste Que ce malheur retombât sur moi Et que vous n’en souffriez pas ; Mais vous aviez le cœur si loyal Que vous l’avez affronté la première. Aussi ferai-je justice de moi-même Pour la trahison que j’ai commise. » Il a tiré du fourreau une épée suspendue à une poutre Et s’en frappe en plein cœur. Il se laisse tomber sur l’autre corps, Il a tant perdu de sang qu’il en meurt.
Version dans l’« Heptaméron » de Marguerite de Navarre « Ô Amour, Par ignoramment aimer je vous ai offensé , aussi vous ne voulez me secourir comme vous l‘avez fait celle qui a gardé toutes vos lois. Ce n’est pas la raison que par si honnête moyen je définis, mais raisonnable que ce soit par ma propre main. Puisque avec mes larmes j’ai lavé votre visage, et avec ma langue je vous ai requis pardon, il ne reste plus sinon qu’avec ma main je rende mon corps semblable au vôtre, et laisse aller mon âme où ira la vôtre, sachant qu’un amour vertueux et honnête n’a jamais fin en ce monde ni en l’autre. » Et à l’heure, se levant de dessus le corps mort de s’amie comme un homme forcené et hors du sens, tira son épée et, par grande violence, s’en donna au travers du cœur. Et derechef prit s’amie entre ses bras, la baisant par telle affection qu’il semblait plus être atteint d’amour que de la mort. »
1.5.1. La Guerre''' par Henri Rousseau, dit le Douanier (1844-1910)
Vers 1894 Huile sur toile H. 114 ; L. 195 cm © RMN-Grand Palais (Musée d'Orsay) / DR
Notice complète
La Guerre 
Plus de vingt ans après le conflit franco-prussien de 1870 et la Commune de 1871, c'est encore marqué par ces évènements que le Douanier Rousseau peint La Guerre. Au centre, un personnage féminin grimaçant tient une épée et une torche. Cette sorte de Bellone, déesse romaine de la guerre, monte un cheval qui ressemble plutôt à un monstre hybride. Le sol sombre est recouvert d'un amas de corps, des corbeaux se repaissent de cette charogne humaine. Les arbres semblent calcinés. Les nuages sont rouges. Sans élément anecdotique ou narratif, Rousseau parvient à mettre le drame en image. L'abondance des formes déchiquetées et surtout le choix des couleurs y concourent : le vert de l'espérance est totalement absent ; dominent le noir et le rouge, couleurs du deuil et du sang.
Parmi les sources possibles de La Guerre, un emprunt semble évident. Il s'agit de la posture du cheval, sorte de "galop volant", qui correspond exactement à celle des chevaux du Derby d'Epsom de Géricault (1821, Paris, musée du Louvre). Pourtant, grâce à la décomposition du mouvement par la photographie, on sait à l'époque de Rousseau que cette position est fausse et n'intervient jamais dans lors du galop d'un cheval. La Nuit d'Hodler peut également être citée. Dans ce tableau, exposé avec un grand retentissement au Salon des Artistes Français de 1891, les corps allongés parallèlement au plan de la toile, la gamme colorée et la présence de la Mort au centre de la composition sont autant d'éléments qui auraient pu être suggérés à Rousseau par Hodler.
Au Salon de Indépendants de 1894, La Guerre est accueillie soit par des sarcasmes, à cause de son aspect maladroit, soit avec enthousiasme, pour sa totale indépendance de style. Ainsi, le jeune peintre Louis Roy écrit dans Le Mercure de France : "cette manifestation a pu paraître étrange parce qu'elle n'évoquait aucune idée de chose déjà vue. N'est-ce point là une qualité maîtresse? [Rousseau] a le mérite, rare aujourd'hui, d'être absolument personnel. Il tend vers un art nouveau...".
1.5.2. La guerre vue par Antonin Mercié David'''
Antonin Mercié (1854-1916)
 David
DavidVers 1872 Statue en bronze H. 184,1 ; L. 76,8 ; P. 83,2 cm © RMN-Grand Palais (Musée d'Orsay) / Jean Schormans
Notice complète David
Avec la guerre de 1870 et la défaite du pays, la société française est gagnée par un sentiment d'humiliation et le désir de revanche. Un tel état d'esprit fait voir dans ce David la promesse d'une France qui un jour terrassera, malgré sa faiblesse, le Goliath prussien, à l'image du jeune berger d'Israël qui, avec la seule aide de sa fronde, abattit le géant ennemi. Aussi la sculpture a-t'elle immédiatement un immense succès : le plâtre exécuté à Rome, où le jeune artiste finit sa formation, lui vaut la Légion d'honneur, et est commandé en bronze par l'Etat en 1872, puis placé au musée du Luxembourg - le musée des artistes vivants - dès 1874. Il devient l'une des images les plus diffusées dans les journaux illustrés, et connaît un tel engouement qu'il est édité en petite taille, et en six dimensions différentes par le fondeur Barbedienne.
Au tournant de 1870, Antonin Mercié incarne la jeune génération de sculpteurs français qui souhaite donner, au coeur d'un enseignement classique, une expression plus vibrante à leurs figures. Il cherche cette alliance entre composition savante et modelé nerveux dans les grands modèles de la Renaissance florentine : de là les grandes et belles courbes du bras prolongé par le mouvement de l'épée, de la jambe ployée, la grâce du mouvement de David qui invite le spectateur à tourner autour des différents plans qui modulent progressivement l'espace. Entre classicisme moderne et réalisme explicite, Mercié trouve une voie originale.
1.5.4. La guerre vue par Raymond Duchamp-Villon
Son Cheval, réalisé en 1914, montre son intérêt pour la mécanique et sa recherche pour une sculpture refusant tout modelage naturaliste. Mobilisé en 14, il est d’abord atteint de fièvre typhoïde en 1916, et, hospitalisé à l’hôpital de Mourmelon, il y réalisa ce coq aux accents patriotiques.

2.1.2. L'amour et la guerre par Michelle Perrot : "La guerre a bouleversé l'amour" (Blaise Cendrars)
Professeure émérite de l’Université Paris 7-Denis Diderot, Michelle Perrot est historienne et écrivaine. Elle a développé ses recherches dans plusieurs directions : le travail (Les ouvriers en grève, Mouton, 1974), la délinquance et les prisons (Les ombres de l’histoire, Flammarion, « Champs », 2003), la vie privée (tome IV de Histoire de la vie privée, Ariès et Duby, dir., 1987) et surtout l’histoire des femmes, qu’elle a contribué à faire émerger en France. Elle a co-dirigé avec Georges Duby l’Histoire des femmes en Occident. De l’Antiquité à nos jours (Plon, 1991-1992). Parmi ses livres récents, on peut citer : Les femmes ou les silences de l’histoire, Flammarion, « Champs », 2003, Mon histoire des femmes, Point Seuil, 2008, Histoire de chambres (Prix Femina/Essai 2009), Mélancolie ouvrière (Grasset, 2012) et Des femmes rebelles. Olympe de Gouges, Flora Tristan, George Sand, Elyzad, 2013. Michelle Perrot a été co-productrice des « Lundis de l’Histoire » (France Culture) de 1986 à 2014 et des « Rendez-vous de l’Histoire » de Blois depuis l’origine.
2.2. La Première Guerre Mondiale
La guerre qui commence en 1914 n’est pas encore la Grande Guerre. Elle engendre néanmoins dès son déclenchement un ensemble de mythes qui lui sont propres. La mobilisation massive de l’Europe la distingue immédiatement des conflits précédents. Mais il faut aussi isoler cette mythologie des légendes qui incarnent la Première Guerre mondiale dans la mémoire des populations. Examinerle dossier publié par la BNF sur la guerre de 14-18 et construire une réflexion sur la mythologisation de la guerre.
2.3.1. Explications de textes
- "La guerre n'est rien d'autre qu'un duel amplifié. Si nous voulons saisir comme une unité l'infinité des duels particuliers dont elle se compose, représentons-nous deux combattants : chacun cherche, en employant sa force physique, à ce que l'autre exécute sa volonté ; son but immédiat est de terrasser l'adversaire et de le rendre ainsi incapable de toute résistance.
La guerre est un acte de violence engagé pour contraindre l'adversaire à se soumettre à notre volonté. Pour affronter la violence, la violence s'arme des inventions des arts et des sciences. Elle se fixe elle-même, sous le nom de lois du droit naturel, des restrictions imperceptibles, à peine notables, qui l'accompagnent sans affaiblir fondamentalement sa force. La violence, c'est-à-dire la violence physique (car il n'en existe pas de morale en dehors des notions d'État et de loi), est donc le moyen. Imposer notre volonté à l'ennemi en constitue la fin. Pour atteindre cette fin avec certitude nous devons désarmer l'ennemi. Lui ôter tout moyen de se défendre est, par définition, le véritable objectif de l'action militaire. Il remplace la fin et l'écarte en quelque sorte comme n'appartenant pas à la guerre elle-même. Ainsi les âmes philanthropiques pourraient-elles facilement s'imaginer qu'il existe une manière artificielle de désarmer ou de terrasser l'adversaire sans causer trop de blessures, et que c'est là la véritable tendance de l'art de la guerre. Il faut pourtant dissiper cette erreur, aussi belle soit-elle. Car, dans une entreprise aussi dangereuse que la guerre, les erreurs engendrées par la bonté sont précisément les pires. Puisque l'utilisation de la violence physique dans toute son ampleur n'exclut en aucune manière la coopération de l'intelligence, celui qui se sert de cette violence avec brutalité, sans épargner le sang, l'emportera forcément sur l'adversaire qui n'agit pas de même. Il dicte par là sa loi à l'autre. Tous deux se poussent ainsi mutuellement jusqu'à une extrémité qui ne connaît d'autre limite que le contrepoids exercé par l'adversaire. C'est ainsi qu'il faut envisager les choses, et c'est un effort vain, absurde même, que d'écarter la nature de l'élément brutal en raison de la répugnance qu'il inspire. Si les guerres des peuples cultivés sont bien moins cruelles et destructrices que celles des peuples incultes, cela tient à la situation sociale de ces États, aussi bien entre eux que chacun d'entre eux. La guerre résulte de cette situation et des conditions qu'elle impose : celle-ci la détermine, la limite et la modère. Mais ces aspects ne font pas essentiellement partie de la guerre, ils n'en sont que les données. Il est donc impossible d'introduire dans la philosophie de la guerre un principe de modération sans commettre une absurdité. Le combat entre les hommes se compose en réalité de deux éléments distincts : le sentiment hostile et l'intention hostile. Nous avons choisi le dernier de ces deux éléments comme caractéristique de notre définition car il est le plus général. Même l'emportement de haine le plus sauvage, le plus proche de l'instinct, n'est pas concevable sans intention hostile. En revanche, la plupart des intentions hostiles ne sont jamais, ou rarement, dominées par l'hostilité des sentiments. Chez les peuples sauvages prédominent les intentions appartenant au domaine du cœur, chez les peuples civilisés, celles qui relèvent de l'entendement. Cette différence ne tient cependant pas à la sauvagerie et à la civilisation en elles-mêmes, mais aux circonstances concomitantes, aux institutions, etc. Elle n'est donc pas nécessairement présente dans chaque cas particulier, mais elle l'emporte dans la majorité d'entre eux. En un mot, même les peuples les plus civilisés peuvent se déchaîner l'un contre l'autre, enflammés par la haine.On voit par là combien il serait faux de ramener la guerre entre les nations civilisées uniquement à un acte rationnel de leurs gouvernements, et d'imaginer qu'elle se libère toujours davantage des passions : au point d'en arriver à se passer des masses physiques des forces armées au profit de leurs seuls rapports théoriques, en une sorte d'algèbre de l'action. La théorie commençait à s'engager dans cette direction lorsque les événements des dernières guerres en montrèrent une meilleure. Si la guerre est un acte de violence, la passion en fait aussi nécessairement partie. Si la guerre n'en procède pas, elle y ramène pourtant plus ou moins. Et ce plus ou moins ne dépend pas du degré de culture, mais de l'importance et de la durée des intérêts antagonistes. Lorsque nous voyons que les peuples civilisés ne mettent pas leurs prisonniers à mort et ne ravagent pas villes et campagnes, cela est dû à la place croissante que prend l'intelligence dans leur conduite de la guerre. Elle leur a appris un emploi de la violence plus efficace que cette manifestation sauvage de l'instinct. L'invention de la poudre, le développement continu des armes à feu montrent suffisamment qu'en progressant la civilisation n'a absolument pas entravé ou détourné la tendance sur laquelle le concept de la guerre, celle d'anéantir l'ennemi. Nous réitérons notre thèse : la guerre est un acte de violence, et l'emploi de celle-ci ne connaît pas de limites. Chacun des adversaires impose sa loi à l'autre. Il en résulte une interaction qui, selon la nature de son concept, doit forcément conduire aux extrêmes." Clausewitz, De la guerre, 1832, Chapitre 1, § 2 et 3, tr. fr. Nicolas Wacquet, Rivages poche, Petite Bibliothèque, p. 19-22.
Comprendre le texte
Relever tous les termes proches
- Qu'en conclure?
- Quel est le lien entre le politique et la guerre?
- "La guerre est une lutte armée entre unités politiques organisées, la guerre civile est une lutte armée au sein d'une unité politique (remise en question de ce fait). La caractéristique essentielle d'une arme est d'être un moyen de provoquer la mort physique d'êtres humains. À l'exemple du mot ennemi, le mot lutte doit être entendu ici dans son sens original et existentiel. Ce n'est pas une simple concurrence que ce mot désigne, ni la lutte purement intellectuelle de la discussion, ni cette lutte symbolique dans laquelle finalement chaque homme est de quelque manière engagé à tout instant puisque les choses sont ainsi faites, et que la vie humaine tout entière est un combat et tout homme un combattant. Les concepts d'ami, d'ennemi, de combat tirent leur signification objective de leur relation permanente à ce fait réel, la possibilité de provoquer la mort physique d'un homme. La guerre naît de l'hostilité, celle-ci étant la négation existentielle d'un autre être. La guerre n'est que l'actualisation ultime de l'hostilité. Ceci n'implique pas qu'elle soit chose courante, chose normale, ni d'ailleurs que l'on y voie une solution idéale ou désirable ; elle reste néanmoins présente nécessairement sous forme d'une possibilité du réel tant que la notion d'ennemi garde son sens.
Les choses ne se présentent donc nullement comme si l'existence politique n'était qu'une guerre sanglante et chaque acte politique une opération militaire, comme si sans cesse chaque peuple face à chaque autre peuple était acculé de façon permanente à l'alternative ami ou ennemi, comme si la décision politiquement bonne ne pouvait pas être celle qui précisément évite la guerre. La définition que nous donnons ici du politique n'est ni belliciste, ni militariste, ni impérialiste, ni pacifiste. Elle n'est pas davantage une tentative de présenter la guerre victorieuse ou la révolution réussie comme un idéal social, car la guerre ou la révolution ne sont ni un fait social, ni un fait idéal. Quant au combat militaire considéré en lui-même, il n'est pas la poursuite de la politique par d'autres moyens, pour rappeler la façon, d'ailleurs inexacte, dont on cite habituellement le mot célèbre de Clausewitz ; il a, en tant que guerre, son optique et ses règles propres, stratégiques, tactiques et autres, qui supposent cependant toutes que la décision politique, celle qui désigne l'ennemi, est un fait donné préalable. Dans une guerre, les adversaires s'affrontent en général ouvertement comme tels, ils se distinguent même normalement par leur uniforme, et de ce fait la discrimination de l'ami et de l'ennemi n'est plus un problème politique que le soldat au combat aurait à résoudre. D'où la justesse de cette remarque d'un diplomate anglais, qui prétend que l'homme politique est mieux entraîné au combat que le soldat parce que l'homme politique se bat toute sa vie, alors que le soldat ne le fait qu'exceptionnellement. La guerre est loin d'être l'objectif, la fin, voire la substance du politique, mais elle est cette hypothèse, cette réalité éventuelle qui gouverne selon son mode propre la pensée et l'action des hommes, déterminant de la sorte un comportement spécifiquement politique. C'est pourquoi le critère qui consiste en la discrimination de l'ami et de l'ennemi ne signifie nullement non plus qu'un peuple donné sera éternellement l'ami ou l'ennemi d'un autre peuple donné, ou qu'une neutralité n'est pas chose possible, qu'elle est un non-sens politique. Simplement, comme tout concept politique, le concept de neutralité, lui aussi, reste subordonné à l'hypothèse dernière, celle de la possibilité effective d'un regroupement en amis et ennemis ; et s'il n'y avait plus sur terre que de la neutralité, ce serait la fin, non seulement de toute guerre, mais aussi celle de la neutralité elle-même, tout comme c'est la fin de toute politique, y compris celle d'une politique visant à éviter le combat, dès lors que l'éventualité concrète du combat disparaît. Les seuls facteurs déterminants sont l'éventualité de la situation décisive, c'est-à-dire celle du combat réel, et l'acte de décider si cette situation est donnée ou non. Or, le caractère exceptionnel de cette situation, loin d'en annuler l'importance déterminante, fonde précisément celle-ci. Si, de nos jours, les guerres ne sont plus aussi nombreuses et aussi communes que jadis, en revanche, l'emprise totale et l'énormité de leur puissance de choc s'est accrue dans la proportion où elles se sont faites moins fréquentes et moins banales, et peut-être plus encore. Le cas de guerre est resté, jusque dans le présent, l'épreuve décisive par excellence. En cette occasion comme en beaucoup d'autres, on peut dire que c'est la situation d'exception qui revêt une signification particulièrement déterminante, révélatrice du fond des choses. Car il faut qu'il y ait lutte réelle pour que se manifeste la logique ultime de la configuration politique qui oppose l'ami et l'ennemi. C'est dans la perspective de cette éventualité extrême que la vie des hommes s'enrichit de sa polarité spécifiquement politique. Un monde d'où l'éventualité de cette lutte aurait été entièrement écartée et bannie, une planète définitivement pacifiée serait un monde sans discrimination de l'ami et de l'ennemi et par conséquent un monde sans politique. Ce monde-là pourrait présenter une diversité d'oppositions et de contrastes peut-être intéressants, toutes sortes de concurrences et d'intrigues, mais il ne présenterait logiquement aucun antagonisme au nom duquel on pourrait demander à des êtres humains de faire le sacrifice de leur vie et donner à certains le pouvoir de répandre le sang et de tuer d'autres hommes."
Carl Schmitt, La notion de politique, 1932, tr. Steinhauser, Champs Flammarion, 1992, p. 70-73.