Textes
L'application pratique du droit à la liberté est le droit humain à la propriété privée. En quoi consiste le droit de l'homme à la propriété privée? Article 16 (Constitution de 1793). - « Le droit de propriété est celui qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie. » Le droit de l'homme à la propriété privée est donc le droit de jouir et de disposer de sa fortune arbitrairement (à son gré), sans se rapporter à d'autres hommes, indépendamment de la société, c'est le droit à l'égoïsme. Cette liberté individuelle-là, de même que son application, constituent le fondement de la société bourgeoise. A chaque homme elle fait trouver en l'autre homme, non la réalisation, mais au contraire la limite de sa liberté. Mais elle proclame avant tout le droit de l'homme « de jouir et de disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie ». Marx (Karl) A propos de la question juive | On comprend donc que l’humanité ne soit venue à la démocratie que sur le tard (car ce furent de fausses démocraties que les cités antiques, bâties sur l’esclavage, débarrassées par cette iniquité fondamentale des plus gros et des plus angoissants problèmes). De toutes les conceptions politiques c’est en effet la plus éloignée de la nature, la seule qui transcende, en intention au moins, les conditions de la « société close ». Elle attribue à l’homme des droits inviolables. Ces droits, pour rester inviolés, exigent de la part de tous une fidélité inaltérable au devoir. Elle prend donc pour matière un homme idéal, respectueux des autres comme de lui-même, s’insérant dans des obligations qu’il tient pour absolues, coïncidant si bien avec cet absolu qu’on ne peut plus dire si c’est le devoir qui confère le droit ou le droit qui impose le devoir. Le citoyen ainsi défini est à la fois « législateur et sujet », pour parler comme Kant. L’ensemble des citoyens, c’est-à-dire le peuple, est donc souverain. Telle est la démocratie théorique. Elle proclame la liberté, réclame l’égalité, et réconcilie ces deux sœurs ennemies en leur rappelant qu’elles sont sœurs, en mettant au-dessus de tout la fraternité. Qu’on prenne de ce biais la devise républicaine, on trouvera que le troisième terme lève la contradiction si souvent signalée entre les deux autres, et que la fraternité est l’essentiel: ce qui permettrait de dire que la démocratie est d’essence évangélique, et qu’elle a pour moteur l’amour. On en découvrirait les origines sentimentales dans l’âme de Rousseau, les principes philosophiques dans l’œuvre de Kant, le fond religieux chez Kant et chez Rousseau ensemble: on sait ce que Kant doit à son piétisme, Rousseau à un protestantisme et à un catholicisme qui ont interféré ensemble. La Déclaration américaine d’indépendance (1776), qui servit de modèle à la Déclaration des droits de l’homme en 1791, a d’ailleurs des résonances puritaines: « Nous tenons pour évident... que tous les hommes ont été doués par leur Créateur de certains droits inaliénables.... etc. » Les objections tirées du vague de la formule démocratique viennent de ce qu’on en a méconnu le caractère originellement religieux. Comment demander une définition précise de la liberté et de l’égalité, alors que l’avenir doit rester ouvert à tous les progrès, notamment à la création de conditions nouvelles où deviendront possibles des formes de liberté et d’égalité aujourd’hui irréalisables, peut-être inconcevables? On ne peut que tracer des cadres, ils se rempliront de mieux en mieux si la fraternité y pourvoit. Ama, et fac quod vis. La formule d’une société non démocratique, qui voudrait que sa devise correspondît, terme à terme, à celle de la démocratie, serait « Autorité, hiérarchie, fixité ». Voilà donc la démocratie dans son essence. Il va sans dire qu’il y faut voir simplement un idéal, ou plutôt une direction où acheminer l’humanité. D’abord, c’est surtout comme protestation qu’elle s’est introduite dans le monde. Chacune des phrases de la Déclaration des droits de l’homme est un défi jeté à un abus. Il s’agissait d’en finir avec des souffrances intolérables. Résumant les doléances présentées dans les cahiers des États généraux, Émile Faguet a écrit quelque part que la Révolution ne s’était pas faite pour la liberté et l’égalité, mais simplement « parce qu’on crevait de faim ». A supposer que ce soit exact, il faudrait expliquer pourquoi c’est à partir d’un certain moment qu’on n’a plus voulu « crever de faim ». Il n’en est pas moins vrai que si la Révolution formula ce qui devait être, ce fut pour écarter ce qui était. Or il arrive que l’intention avec laquelle une idée a été lancée y reste invisiblement adhérente, comme à la flèche sa direction. Les formules démocratiques, énoncées d’abord dans une pensée de protestation, se sont ressenties de leur origine. On les trouve commodes pour empêcher, pour rejeter, pour renverser; il est moins facile d’en tirer l’indication positive de ce qu’il faut faire. Surtout, elles ne sont applicables que si on les transpose, absolues et quasi évangéliques, en termes de moralité purement relative, ou plutôt d’intérêt général; et la transposition risque toujours d’amener une incurvation dans le sens des intérêts particuliers. Mais il est inutile d’énumérer les objections élevées contre la démocratie et les réponses qu’on y fait. Nous avons simplement voulu montrer dans l’état d’âme démocratique un grand effort en sens inverse de la nature. Bergson (Henri) Les deux sources de la morale et de la religion, p 304. | ` |
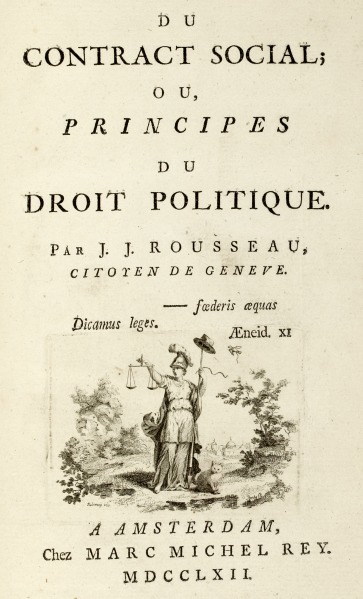 | Voter, ce n’est pas précisément un des droits de l’Homme; on vivrait très bien sans voter, si l’on avait la sûreté, l’égalité, la liberté. Le vote n’est qu’un moyen de conserver tous ces biens. L’expérience a fait voir cent fois qu’une élite gouvernante, qu’elle gouverne d’après l’hérédité, ou par la science acquise, arrive très vite à priver les citoyens de toute liberté, si le peuple n’exerce pas un pouvoir de contrôle, de blâme et enfin de renvoi. Quand je vote, je n’exerce pas un droit, je défends tous mes droits. Il ne s’agit donc pas de savoir si mon vote est perdu ou non, mais bien de savoir si le résultat cherché est atteint, c’est-à-dire si les pouvoirs sont contrôlés, blâmés et enfin détrônés dès qu’ils méconnaissent les droits des citoyens. On conçoit très bien un système politique, par exemple le plébiscite[1], où chaque citoyen votera une fois librement, sans que ses droits soient pour cela bien gardés. Aussi je ne tiens pas tant à choisir effectivement, et pour ma part, tel ou tel maître, qu’à être assuré que le maître n’est pas le maître, mais seulement le serviteur du peuple. C’est dire que je ne changerai pas mes droits réels pour un droit fictif. [1] Plébiscite: Vote par lequel un peuple abandonne le pouvoir à un homme. Alain |
Certes, ce sont les faibles, la masse des gens, qui établissent les lois, j'en suis sûr. C'est donc en fonction d'eux-mêmes et de leur intérêt personnel que les faibles font les lois, qu'ils attribuent des louanges, qu'ils répartissent des blâmes. Ils veulent faire peur aux hommes plus forts qu'eux et qui peuvent leur être supérieurs. C'est pour empêcher que ces hommes ne leur soient supérieurs qu'ils disent qu'il est vilain, qu'il est injuste, d'avoir plus que les autres et que l'injustice consiste justement à vouloir avoir plus. Car, ce qui plaît aux faibles, c'est d'avoir l'air d'être égaux à de tels hommes, alors qu'ils leur sont inférieurs. Et quand on dit qu'il est injuste, qu'il est vilain, de vouloir avoir plus que la plupart des gens, on s'exprime en se référant à la loi. Or, au contraire, il est évident, selon moi, que la justice consiste en ce que le meilleur ait plus que le moins bon et le plus fort plus que le moins fort. Partout il en est ainsi, c'est ce que la nature enseigne, chez toutes les espèces animales, chez toutes les races humaines et dans toutes les cités! Si le plus fort domine le moins fort et s'il est supérieur à lui, c'est là le signe que c'est juste. De quelle justice Xerxès s'est-il servi lorsque avec son armée il attaqua la Grèce (1), ou son père quand il fit la guerre aux Scythes? Et encore, ce sont là deux cas parmi des milliers d'autres à citer! Eh bien, Xerxès et son père ont agi, j'en suis sûr, conformément à la nature du droit - c'est-à-dire conformément à la loi, oui, par Zeus, à la loi de la nature -, mais ils n'ont certainement pas agi en respectant la loi que nous établissons, nous! Chez nous, les êtres les meilleurs et les plus forts, nous commençons à les façonner, dès leur plus jeune âge, comme on fait pour dompter les lions; avec nos formules magiques et nos tours de passe-passe, nous en faisons des esclaves, en leur répétant qu'il faut être égal aux autres et que l'égalité est ce qui est beau et juste. Mais, j'en suis sûr, s'il arrivait qu'un homme eût la nature qu'il faut pour secouer tout ce fatras, le réduire en miettes et s'en délivrer, si cet homme pouvait fouler aux pieds nos grimoires, nos tours de magie, nos enchantements, et aussi toutes nos lois qui sont contraires à la nature - si cet homme, qui était un esclave, se redressait et nous apparaissait comme un maître, alors, à ce moment-là, le droit de la nature brillerait de tout son éclat.
(1) allusion à la seconde guerre médique conduite par Xerxès, roi des Perses, qui envahit la Grèce en 480 av. JC Platon Gorgias, 483b-484a, trad. Canto, Garnier-Flammarion, 1987, pp. 212-213. | Lorsque je songe aux petites passions des hommes de nos jours, à la mollesse de leurs moeurs, à l'étendue de leurs lumières, à la pureté de leur religion, à la douceur de leur morale, à leurs habitudes laborieuses et rangées, à la retenue qu'ils conservent presque tous dans le vice comme dans la vertu, je ne crains pas qu'ils rencontrent dans leurs chefs des tyrans, mais plutôt des tuteurs. Je pense donc que l'espèce d'oppression dont les peuples démocratiques sont menacés ne ressemblera à rien de ce qui l'a précédée dans le monde; nos contemporains ne sauraient en trouver l'image dans leurs souvenirs. Je cherche en vain moi-même une expression qui reproduise exactement l'idée que je m'en forme et la renferme; les anciens mots de despotisme et de tyrannie ne conviennent point. La chose est nouvelle, il faut donc tacher de la définir, puisque je ne peux la nommer.
Je veux imaginer sous quels traits nouveaux le despotisme pourrait se produire dans le monde: je vois une foule innombrable d'hommes semblables et égaux qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs, dont ils emplissent leur âme. Chacun d'eux, retiré à l'écart, est comme étranger à la destinée de tous les autres: ses enfants et ses amis particuliers forment pour lui toute l'espèce humaine; quant au demeurant de ses concitoyens, il est à côté d'eux, mais il ne les voit pas; il les touche et ne les sent point; il n'existe qu'en lui-même et pour lui seul, et s'il lui reste encore une famille, on peut dire du moins qu'il n'a plus de patrie.
Au-dessus de ceux-la s'élève un pouvoir immense et tutélaire, qui se charge seul d'assurer leur jouissance et de veiller sur leur sort. Il est absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux. Il ressemblerait à la puissance paternelle si, comme elle, il avait pour objet de préparer les hommes à l'âge viril; mais il ne cherche, au contraire, qu'à les fixer irrévocablement dans l'enfance; il aime que les citoyens se réjouissent, pourvu qu'ils ne songent qu'à se réjouir. Il travaille volontiers à leur bonheur; mais il veut en être l'unique agent et le seul arbitre; il pourvoit à leur sécurité, prévoit et assure leurs besoins, facilite leurs plaisirs, conduit leurs principales affaires, dirige leur industrie, règle leurs successions, divise leurs héritages; que ne peut-il leur ôter entièrement le trouble de penser et la peine de vivre?
C'est ainsi que tous les jours il rend moins utile et plus rare l'emploi du libre arbitre; qu'il renferme l'action de la volonté dans un plus petit espace, et dérobe peu a peu chaque citoyen jusqu'à l'usage de lui-même. L'égalité a préparé les hommes à toutes ces choses: elle les a disposés à les souffrir et souvent même à les regarder comme un bienfait.
Après avoir pris ainsi tour à tour dans ses puissantes mains chaque individu, et l'avoir pétri à sa guise, le souverain étend ses bras sur la société tout entière; il en couvre la surface d'un réseau de petites règles compliquées, minutieuses et uniformes, à travers lesquelles les esprits les plus originaux et les âmes les plus vigoureuses ne sauraient se faire jour pour dépasser la foule; il ne brise pas les volontés, mais il les amollit, les plie et les dirige; il force rarement d'agir, mais il s'oppose sans cesse à ce qu'on agisse; il ne détruit point, il empêche de naître; il ne tyrannise point, il gêne, il comprime, il énerve, il éteint, il hébète, et il réduit enfin chaque nation a n'être plus qu'un troupeau d'animaux timides et industrieux, dont le gouvernement est le berger.
J'ai toujours cru que cette sorte de servitude, réglée, douce et paisible, dont je viens de faire le tableau, pourrait se combiner mieux qu'on ne l'imagine avec quelques unes des formes extérieures de la liberté, et qu'il ne lui serait pas impossible de s'établir a l'ombre même de la souveraineté du peuple.
Nos contemporains sont incessamment travaillés par deux passions ennemies: ils sentent le besoin d'être conduits et l'envie de rester libres. Ne pouvant détruire ni l'un ni l'autre de ces instincts contraires, ils s'efforcent de les satisfaire à la fois tous les deux. Ils imaginent un pouvoir unique, tutélaire, tout-puissant, mais élu par les citoyens. Ils combinent la centralisation et la souveraineté du peuple. Cela leur donne quelque relâche. Ils se consolent d'être en tutelle, en songeant qu'ils ont eux mêmes choisi leurs tuteurs. Chaque individu souffre qu'on l'attache, parce qu'il voit que ce n'est pas un homme ni une classe, mais le peuple lui-même, qui tient le bout de la chaîne. Dans ce système, les citoyens sortent un moment de la dépendance pour indiquer leur maître, et y rentrent.
Il y a, de nos jours, beaucoup de gens qui s'accommodent très aisément de cette espèce de compromis entre le despotisme administratif et la souveraineté du peuple, et qui pensent avoir assez garanti la liberté des individus, quand c'est au pouvoir national qu'ils la livrent. Cela ne me suffit point. La nature du maître m'importe bien moins que l'obéissance.
Je ne nierai pas cependant qu'une constitution semblable ne soit infiniment préférable à celle qui, après avoir concentre tous les pouvoirs, les déposerait dans les mains d'un homme ou d'un corps irresponsable. De toutes les différentes formes que le despotisme démocratique pourrait prendre, celle-ci serait assurément la pire.
Lorsque le souverain est électif ou surveillé de près par une législature réellement élective et indépendante, l'oppression qu'il fait subir aux individus est quelquefois plus grande; mais elle est toujours moins dégradante parce que chaque citoyen, alors qu'on le gêne et qu'on le réduit à l'impuissance, peut encore se figurer qu'en obéissant il ne se soumet qu'à lui-même, et que c'est à l'une de ses volontés qu'il sacrifie toutes les autres.
Je comprends également que, quand le souverain représente la nation et dépend d'elle, les forces et les droits qu'on enlève à chaque citoyen ne servent pas seulement au chef de l'Etat, mais profitent à l'Etat lui même, et que les particuliers retirent quelque fruit du sacrifice qu'ils ont fait au public de leur indépendance.
Créer une représentation nationale dans un pays très centralisé, c'est donc diminuer le mal que l'extrême centralisation peut produire, mais ce n'est pas le détruire. Je vois bien que, de cette manière, on conserve l'intervention individuelle dans les plus importantes affaires; mais on ne la supprime pas moins dans les petites et les particulières. L'on oublie que c'est surtout dans le détail qu'il est dangereux d'asservir les hommes. Je serais, pour ma part, porté à croire la liberté moins nécessaire dans les grandes choses que dans les moindres, si je pensais qu'on put jamais être assuré de l'une sans posséder l'autre.
La sujétion dans les petites affaires se manifeste tous les jours et se fait sentir indistinctement à tous les citoyens. Elle ne les désespère point; mais elle les contrarie sans cesse et elle les porte à renoncer à l'usage de leur volonté. Elle éteint peu à peu leur esprit et énerve leur âme, tandis que l'obéissance, qui n'est due que dans un petit nombre de circonstances très graves, mais très rares, ne montre la servitude que de loin en loin et ne la fait peser que sur certains hommes. En vain chargerez-vous ces mêmes citoyens, que vous avez rendus si dépendants du pouvoir central, de choisir de temps à autre les représentants de ce pouvoir; cet usage si important, mais si court et si rare, de leur libre arbitre, n'empêchera pas qu'ils ne perdent peu à peu la faculté de penser, de sentir et d'agir par eux-mêmes, et qu'ils ne tombent ainsi graduellement au-dessous du niveau de l'humanité.
J'ajoute qu'ils deviendront bientôt incapables d'exercer le grand et unique privilège qui leur reste. Les peuples démocratiques qui ont introduit la liberté dans la sphère politique, en même temps qu'ils accroissaient le despotisme dans la sphère administrative, ont été conduits à des singularités bien étranges. Faut-il mener les petites affaires où le simple bon sens peut suffire, ils estiment que les citoyens en sont incapables; s'agit-il du gouvernement de tout l'Etat, ils confient à ces citoyens d'immenses prérogatives; ils en font alternativement les jouets du souverain et ses maîtres, plus que des rois et moins que des hommes. Après avoir épuisé tous les différents systèmes d'élection, sans en trouver un qui leur convienne, ils s'étonnent et cherchent encore; comme si le mal qu'ils remarquent ne tenait pas a la constitution du pays bien plus qu'a celle du corps électoral.
Il est, en effet, difficile de concevoir comment des hommes qui ont entièrement renoncé à l'habitude de se diriger eux-mêmes pourraient réussir à bien choisir ceux qui doivent les conduire; et l'on ne fera point croire qu'un gouvernement libéral, énergique et sage, puisse jamais sortir des suffrages d'un peuple de serviteurs. Une constitution qui serait républicaine par la tête, et ultra-monarchique dans toutes les autres parties, m'a toujours semblé un monstre éphémère. Les vices des gouvernants et l'imbécillité des gouvernés ne tarderaient pas à en amener la ruine; et le peuple, fatigué de ses représentants et de lui-même, créerait des institutions plus libres, ou retournerait bientôt s'étendre aux pieds d'un seul maître. Tocqueville De la démocratie en Amérique, II, vi, 6 |
Chacun sent bien que la force ne peut rien contre le droit; mais beaucoup sont disposés à reconnaître que la force peut quelque chose pour le droit. Ici se présente une difficulté qui paraît insurmontable à beaucoup et qui les jette dans le dégoût de leur propre pensée, sur quoi compte le politique. Ce qui égare d’abord l’esprit, c’est que les règles du droit sont souvent appliquées par la force, avec l’approbation des spectateurs. L’arrestation, l’emprisonnement, la déportation [1], la mort sont des exemples qui frappent. Comment nier que le droit ait besoin de la force? (...) Je suis bien loin de mépriser cet ordre ancien et vénérable que l’agent au carrefour représente si bien. Et je veux remarquer d’abord ceci, c’est que l’autorité de l’agent est reconnue plutôt que subie. Je suis pressé, le bâton levé produit en moi un mouvement d’impatience et même de colère, mais enfin je veux cet ordre au carrefour, et non pas une lutte de force entre les voitures, et le bâton de l’agent me rappelle cette volonté mienne, que la passion allait me faire oublier. Ce que j’exprime en disant qu’il y a un ordre de droit entre l’agent et moi, entre les autres voyageurs et moi, ou bien, si l’on veut dire autrement, un état de paix véritable. Si cet ordre n’est point reconnu et voulu par moi, si je cède seulement à une force évidemment supérieure, il n’y a ni paix ni droit, mais seulement un vainqueur, qui est l’agent, et un vaincu, qui est moi. [1] L’auteur pense ici au bagne de Cayenne. Alain | Il ne paraît pas qu'on puisse amener l'homme par quelque moyen que ce soit à troquer sa nature contre celle d'un termite; il sera toujours enclin à défendre son droit à la liberté individuelle contre la volonté de la masse. Un bon nombre de luttes au sein de l'humanité se livrent et se concentrent autour d'une tâche unique: trouver un équilibre approprié, donc de nature? assurer le bonheur de tous, entre ces revendications de l'individu et les exigences culturelles de la collectivité. Et c'est l'un des problèmes dont dépend le destin de l'humanité que de savoir si cet équilibre est réalisable au moyen d'une certaine forme de civilisation, ou bien si au contraire ce conflit est insoluble. Freud |
« La vengeance se distingue de la punition en ce que l'une est une réparation obtenue par un acte de la partie lésée, tandis que l'autre est l'œuvre d'un juge. Il faut donc que la réparation soit effectuée à titre de punition, car, dans la vengeance, la passion joue son rôle, et le droit se trouve troublé. De plus, la vengeance n'a pas la forme du droit, mais celle de l'arbitraire, car la partie lésée agit toujours par sentiment ou selon un mobile subjectif. Aussi bien, quand le droit se présente sous la forme de la vengeance, il constitue à son tour une nouvelle offense, n'est senti que comme conduite individuelle, et provoque inexorablement, à l'infini, de nouvelles vengeances. » Hegel Propédeutique Philosophique | L’abolition du crime est d’abord, dans cette sphère du droit immédiat, la vengeance; celle-ci est juste dans son contenu si elle est une compensation. Quant à la forme, elle est l’action d’une volonté subjective qui, dans chaque dommage qui se produit, met son indéfini, et dont par suite la justice est contingente. Et aux autres consciences elle apparaît comme une volonté particulière. La vengeance devient une nouvelle violence en tant qu’action positive d’une volonté particulière. Elle tombe par cette contradiction dans le processus de l’infini et se transmet de génération en génération sans limite.
Remarque: Là, où les crimes sont poursuivis et punis non comme crimina publica, mais comme privata (comme le vol et le brigandage chez les Juifs et les Romains et quelque peu encore chez les Anglais), la loi a en elle une partie au moins des caractères de la vengeance. L’exercice de la vengeance par les héros, les chevaliers errants, est différent de la vengeance privée. Elle appartient à la naissance des États. Hegel Principes de la philosophie du droit |
Les hommes prétendent que, par nature, il est bon de commettre l'injustice et mauvais de la souffrir, mais qu'il y a plus de mal à la souffrir que de bien à la commettre. Aussi, lorsque mutuellement ils la commettent et la subissent, et qu'ils goûtent des deux états, ceux qui ne peuvent point éviter l'un ni choisir l'autre estiment utile de s'entendre pour ne plus commettre ni subir l'injustice. De là prirent naissance les lois et les conventions, et l'on appela ce que prescrivait la loi légitime et juste. Voilà l'origine et l'essence de la justice: elle tient le milieu entre le plus grand bien — commettre impunément l'injustice — et le plus grand mal — la subir quand on est incapable de se venger. Entre ces deux extrêmes, la justice est aimée non comme un bien en soi, mais parce que l'impuissance de commettre l'injustice lui donne du prix. En effet, celui qui peut pratiquer cette dernière ne s'entendra jamais avec personne pour s'abstenir de la commettre ou de la subir, car il serait fou. Telle est donc, Socrate, la nature de la justice et telle son origine, selon l'opinion commune.
Maintenant, que ceux qui la pratiquent agissent par impuissance de commettre l'injustice, c'est ce que nous sentirons particulièrement bien si nous faisons la supposition suivante. Donnons licence au juste et à l'injuste de faire ce qu'ils veulent; suivons-les et regardons où, l'un et l'autre, les mène le désir. Nous prendrons le juste en flagrant délit de poursuivre le même but que l'injuste, poussé par le besoin de l'emporter sur les autres: c'est ce que recherche toute nature comme un bien, mais que, par loi et par force, on ramène au respect de l'égalité. La licence dont je parle serait surtout significative s'ils recevaient le pouvoir qu'eut jadis, dit-on, l'ancêtre de Gygès le Lydien. Cet homme était berger au service du roi qui gouvernait alors la Lydie. Un jour, au cours d'un violent orage accompagné d'un séisme, le sol se fendit et il se forma une ouverture béante près de l'endroit où il faisait paître son troupeau. Plein d'étonnement, il y descendit, et, entre autres merveilles que la fable énumère, il vit un cheval d'airain creux, percé de petites portes; s'étant penché vers l'intérieur, il y aperçut un cadavre de taille plus grande, semblait-il, que celle d'un homme, et qui avait à la main un anneau d'or, dont il s'empara; puis il partit sans prendre autre chose. Or, à l'assemblée habituelle des bergers qui se tenait chaque mois pour informer le roi de l'état de ses troupeaux, il se rendit portant au doigt cet anneau. Ayant pris place au milieu des autres, il tourna par hasard le chaton de la bague vers l'intérieur de sa main; aussitôt il devint invisible à ses voisins qui parlèrent de lui comme s'il était parti. Etonné, il mania de nouveau la bague en tâtonnant, tourna le chaton en dehors et, ce faisant, redevint visible. S'étant rendu compte de cela, il répéta l'expérience pour voir si l'anneau avait bien ce pouvoir; le même prodige se reproduisit: en tournant le chaton en dedans il devenait invisible, en dehors visible. Dès qu'il fut sûr de son fait, il fit en sorte d'être au nombre des messagers qui se rendaient auprès du roi. Arrivé au palais, il séduisit la reine, complota avec elle la mort du roi, le tua, et obtint ainsi le pouvoir. Si donc il existait deux anneaux de cette sorte, et que le juste reçût l'un, l'injuste l'autre, aucun, pense-t-on, ne serait de nature assez adamantine pour persévérer dans la justice et pour avoir le courage de ne pas toucher au bien d'autrui, alors qu'il pourrait prendre sans crainte ce qu'il voudrait sur l'agora, s'introduire dans les maisons pour s'unir à qui lui plairait, tuer les uns, briser les fers des autres et faire tout à son gré, devenu l'égal d'un dieu parmi les hommes. En agissant ainsi, rien ne le distinguerait du méchant: ils tendraient tous les deux vers le même but. Et l'on citerait cela comme une grande preuve que personne n'est juste volontairement, mais par contrainte, la justice n'étant pas un bien individuel, puisque celui qui se croit capable de commettre l'injustice la commet. Tout homme, en effet, pense que l'injustice est individuellement plus profitable que la justice, et le pense avec raison d'après le partisan de cette doctrine. Car si quelqu'un recevait cette licence dont j'ai parlé, et ne consentait jamais à commettre l'injustice, ni à toucher au bien d'autrui, il paraîtrait le plus malheureux des hommes, et le plus insensé, à ceux qui auraient connaissance de sa conduite; se trouvant mutuellement en présence ils le loueraient, mais pour se tromper les uns les autres, et à cause de leur crainte d'être eux-mêmes victimes de l'injustice. Voilà ce que j'avais à dire sur ce point. Platon République | On considère l’Etat comme l’antagoniste de l’individu et il semble que le premier ne puisse se développer qu’au détriment du second. La vérité, c’est que l’Etat a été bien plutôt le libérateur de l’individu. C’est l’Etat qui, à mesure qu’il a pris de la force, a affranchi l’individu des groupes particuliers et locaux qui tendaient à l’absorber: famille, cité, corporation, etc. L’individualisme a marché dans l’histoire du même pas que l’étatisme. Non pas que l’Etat ne puisse devenir despotique et oppresseur. Comme toutes les forces de la nature, s’il n’est limité par aucune puissance collective qui le contienne, il se développera sans mesure et deviendra à son tour une menace pour les libertés individuelles. D’où il suit que la force sociale qui est en lui doit être neutralisée par d’autres forces sociales qui lui fassent contrepoids. Si les groupes secondaires sont facilement tyranniques quand leur action n’est pas modérée par celle de l’Etat, inversement celle de l’Etat, pour rester normale, a besoin d’être modérée à son tour. Le moyen d’arriver à ce résultat, c’est qu’il y ait dans la société, en dehors de l’Etat, quoique soumis à son influence, des groupes plus restreints (territoriaux ou professionnels, il n’importe pour l’instant) mais fortement constitués et doués d’une individualité et d’une autonomie suffisante pour pouvoir s’opposer aux empiétements du pouvoir central. Ce qui libère l’individu, ce n’est pas la suppression de tout centre régulateur, c’est leur multiplication, pourvu que ces centres multiples soient coordonnés et subordonnés les uns aux autres. Durkheim L’Etat et la société civile |
Définitions
Partir d'exemples.
- Le PACS
Ce sujet s'intéresse au PACS, à quelques jours de l'examen du projet de loi proposant son instauration. Il dresse en fait le portrait de plusieurs couples afin de montrer les modifications qu'apporterait pour eux le PACS. Chacun de ces couples est censé représenter un cas particulier : l'un s'est marié pour des raisons professionnelles, deux couples homosexuels souhaiteraient pouvoir se transmettre des biens, et un dernier couple vit en concubinage. Ce reportage souligne donc la diversité des situations que recouvrirait le PACS, concernant aussi bien les couples hétérosexuels qu'homosexuels. Les témoignages recueillis revêtent une importance particulière : ce sujet laisse en effet la parole à l'un des deux membres de chaque couple.
- Questions :
- A quel(s) préjugé(s) se heurte le contrat?
- Pourquoi la télévision publique, dépendant de l'Etat, présente-t-elle ce reportage? Quelle est sa "mission"?
- Peut-on dire qu'il y a une faiblesse du droit? Où est le paradoxe?
- De quoi va avoir besoin le droit pour dépasser ce paradoxe?
- Egalité au sein du pacte
Pacte : définition
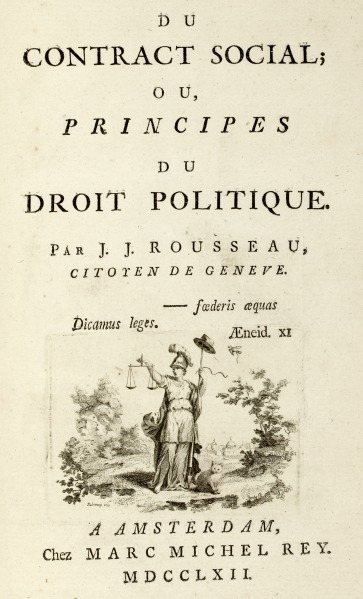
Dans son Contrat social, publié en 1762, Rousseau propose un pacte entre les citoyens dans le but de remédier aux inégalités persistantes de la société. Il examine les conditions, essentielles et circonstancielles, d’une société légitime. Les premières sont exprimées par les notions de contrat social et de volonté générale. Il n’y a de société que formée par la libre volonté de ses membres, aucune autorité que celle de leur volonté commune : « Chacun de nous met en commun sa personne et toute sa puissance sous la suprême direction de la volonté générale ; et nous recevons en corps chaque membre comme partie indivisible du tout ». Mais il faut aussi que des circonstances exceptionnelles permettent à un peuple de recouvrer sa liberté. C’est à cette possibilité que correspond l’idée de révolution.