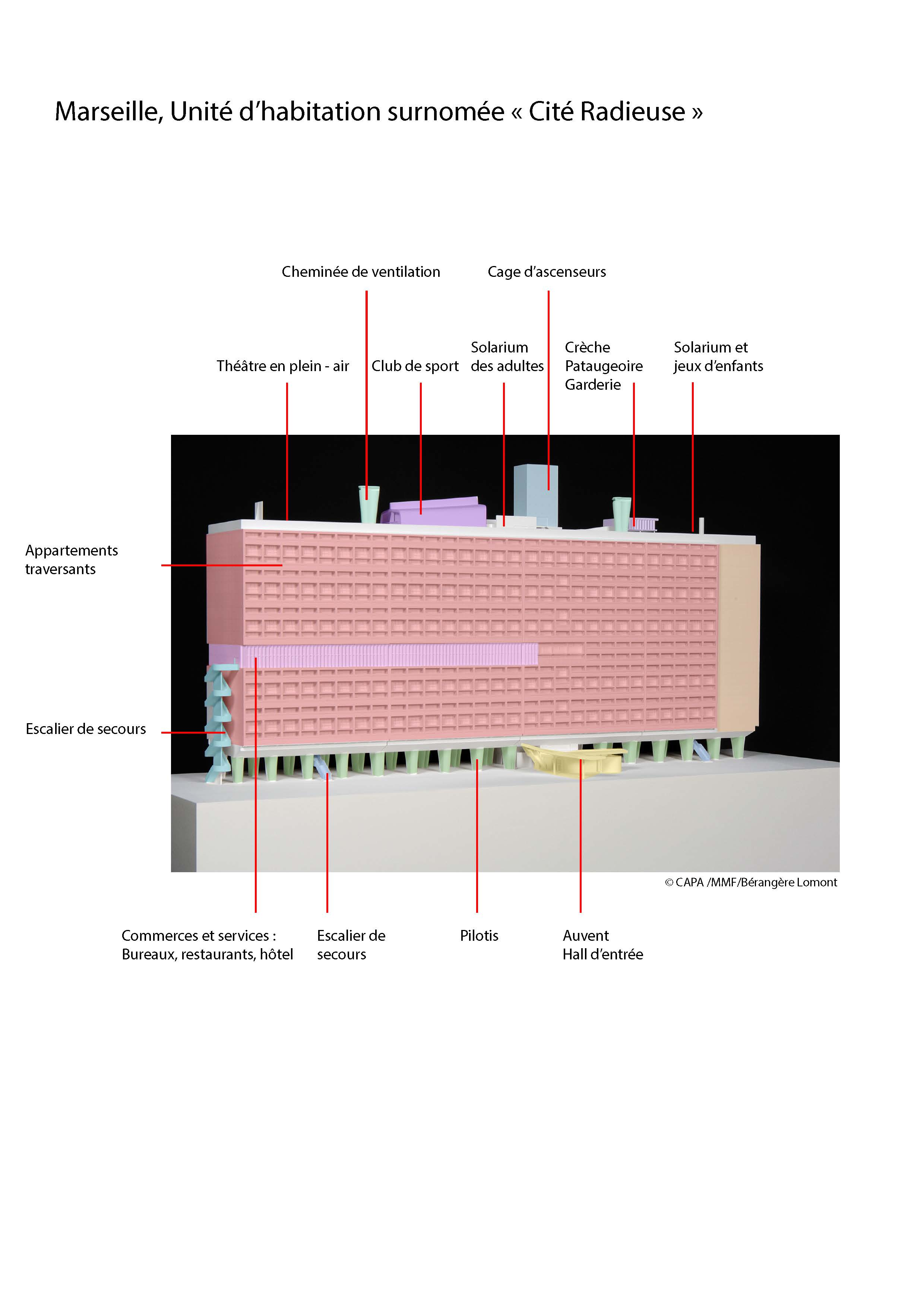L'histoire et l'idéologie
. Introduction : La manipulation des traces permet une réécriture idéologique de l'histoire à des fins politiques:
- Chapitre IV Orwell 1984
Répondre aux questions à partir du texte suivant :
- Quel est le travail de Watson?
- ramener l'histoire à une mémoire n'est-ce pas contestable? Qui crée en effet la mémoire?
Pourquoi faire disparaître les traces?
Peut-on dire qu'il y a un usage politique de l'histoire?
Qu'apporte l'écrit à l'histoirte?
En quoi peut-on dire que l'histoire est une narration?
Avec le soupir inconscient et profond que la proximité même du télécran ne pouvait l’empêcher de pousser lorsqu’il commençait son travail journalier, Winston rapprocha de lui le phonoscript, souffla la poussière du microphone et mit ses lunettes.
Il déroula ensuite et agrafa ensemble quatre petits cylindres de papier qui étaient déjà tombés du tube pneumatique qui se trouvait à la droite du bureau.
Il y avait trois orifices aux murs de là cabine. À droite du phonoscript se trouvait un petit tube pneumatique pour les messages écrits. À gauche, il y avait un tube plus large pour les journaux. Dans le mur de côté, à portée de la main de Winston, il y avait une large fente ovale protégée par un grillage métallique. On se servait de cette fente pour jeter les vieux papiers. Il y avait des milliers et des milliers de fentes semblables dans l’édifice. Il s’en trouvait, non seulement dans chaque pièce mais, à de courts intervalles, dans chaque couloir. On les surnommait trous de mémoire. Lorsqu’un document devait être détruit, ou qu’on apercevait le moindre bout de papier qui traînait, on soulevait le clapet du plus proche trou de mémoire, l’action était automatique, et on laissait tomber le papier, lequel était rapidement emporté par un courant d’air chaud jusqu’aux énormes fournaises cachées quelque part dans les profondeurs de l’édifice.
Winston examina les quatre bouts de papier qu’il avait déroulés. Ils contenaient chacun un message d’une ou deux lignes seulement, dans le jargon abrégé employé au ministère pour le service intérieur. Ce n’était pas exactement du novlangue, mais il comprenait un grand nombre de mots novlangue. Ces messages étaient ainsi rédigés:
times 17-3-84 discours malreporté afrique rectifier
times 19-12-83 prévisions 3 ap 4e trimestre 83 erreurs typo vérifier numéro de ce jour.
times 14-2-84 miniplein chocolat malcoté rectifier
times 3-12-83 report ordrejour bb trèsmauvais ref unpersonnes récrire entier soumettrehaut anteclassement.
Avec un léger soupir de satisfaction, Winston mit de côté le quatrième message. C’était un travail compliqué qui comportait des responsabilités et qu’il valait mieux entreprendre en dernier lieu. Les trois autres ne demandaient que de la routine, quoique le second impliquât probablement une fastidieuse étude de listes de chiffres.
Winston composa sur le télécran les mots: « numéros anciens » et demanda les numéros du journal le Times qui lui étaient nécessaires. Quelques minutes seulement plus tard, ils glissaient du tube pneumatique. Les messages qu’il avait reçus se rapportaient à des articles, ou à des passages d’articles que, pour une raison ou pour une autre, on pensait nécessaire de modifier ou, plutôt, suivant le terme officiel, de rectifier.
Par exemple, dans le Times du 17 mars, il apparaissait que Big Brother dans son discours de la veille, avait prédit que le front de l’Inde du Sud resterait calme. L’offensive eurasienne serait bientôt lancée contre l’Afrique du Nord. Or, le haut commandement eurasien avait lancé son offensive contre l’Inde du Sud et ne s’était pas occupé de l’Afrique du Nord. Il était donc nécessaire de réécrire le paragraphe erroné du discours de Big Brother afin qu’il prédise ce qui était réellement arrivé.
De même, le Times du 19 décembre avait publié les prévisions officielles pour la production de différentes sortes de marchandises de consommation au cours du quatrième trimestre 1983 qui était en même temps le sixième trimestre du neuvième plan triennal. Le journal du jour publiait un état de la production réelle. Il en ressortait que les prévisions avaient été, dans tous les cas, grossièrement erronées. Le travail de Winston était de rectifier les chiffres primitifs pour les faire concorder avec les derniers parus.
Quant au troisième message, il se rapportait à une simple erreur qui pouvait être corrigée en deux minutes. Il n’y avait pas très longtemps, c’était au mois de février, le ministère de l’Abondance avait publié la promesse (en termes officiels, l’engagement catégorique) de ne pas réduire la ration de chocolat durant l’année 1984. Or, la ration, comme le savait Winston, devait être réduite de trente à vingt grammes à partir de la fin de la semaine. Tout ce qu’il y avait à faire, c’était de substituer à la promesse primitive l’avis qu’il serait probablement nécessaire de réduire la ration de chocolat dans le courant du mois d’avril.
Dès qu’il avait fini de s’occuper de l’un des messages, Winston agrafait ses corrections phonoscriptées au numéro correspondant du Times et les introduisait dans le tube pneumatique. Ensuite, d’un geste autant que possible inconscient, il chiffonnait le message et les notes qu’il avait lui-même faites et les jetait dans le trou de mémoire afin que le tout fût dévoré par les flammes.
Que se passait-il dans le labyrinthe où conduisaient les pneumatiques? Winston ne le savait pas en détail, mais il en connaissait les grandes lignes. Lorsque toutes les corrections qu’il était nécessaire d’apporter à un numéro spécial du Times avaient été rassemblées et collationnées, le numéro était réimprimé. La copie originale était détruite et remplacée dans la collection par la copie corrigée.
Ce processus de continuelles retouches était appliqué, non seulement aux journaux, mais aux livres, périodiques, pamphlets, affiches, prospectus, films, enregistrements sonores, caricatures, photographies. Il était appliqué à tous les genres imaginables de littérature ou de documentation qui pouvaient comporter quelque signification politique ou idéologique. Jour par jour, et presque minute par minute, le passé était mis à jour. On pouvait ainsi prouver, avec documents à l’appui, que les prédictions faites par le Parti s’étaient trouvées vérifiées. Aucune opinion, aucune information ne restait consignée, qui aurait pu se trouver en conflit avec les besoins du moment. L’Histoire tout entière était un palimpseste gratté et réécrit aussi souvent que c’était nécessaire. Le changement effectué, il n’aurait été possible en aucun cas de prouver qu’il y avait eu falsification.
La plus grande section du Commissariat aux Archives, bien plus grande que celle où travaillait Winston, était simplement composée de gens dont la tâche était de rechercher et rassembler toutes les copies de livres, de journaux et autres documents qui avaient été remplacées et qui devaient être détruites. Un numéro du Times pouvait avoir été réécrit une douzaine de fois, soit par suite de changement dans la ligne politique, soit par suite d’erreurs dans les prophéties de Big Brother. Mais il se trouvait encore dans la collection avec sa date primitive. Aucun autre exemplaire n’existait qui pût le contredire. Les livres aussi étaient retirés de la circulation et plusieurs fois réécrits. On les rééditait ensuite sans aucune mention de modification. Même les instructions écrites que recevait Winston et dont il se débarrassait invariablement dès qu’il n’en avait plus besoin, ne déclaraient ou n’impliquaient jamais qu’il s’agissait de faire un faux. Il était toujours fait mention de fautes, d’omissions, d’erreurs typographiques, d’erreurs de citation, qu’il était nécessaire de corriger dans l’intérêt de l’exactitude.
Orwell (George)
1984
Brûler les livres. Fahrenheit 451
Etude du film de François Truffaut
À quoi ressemble un monde qui brûle les livres ?
- Très rythmée et très découpée, la séquence liminaire de Fahrenheit 451 tisse nombre de ficelles idéologiques et dramaturgiques. Annonçant également sa rupture avec les codes propres au genre, cette séquence procède par énigmes successives et prend le spectateur à contre-pied. Au final, le pouvoir omnipotent et répressif de la société de Fahrenheit oppose un visage plutôt tranquille.
- Urgence, discipline, efficacité... Une escouade de pompiers descend d’un mât et prend place sur une voiture d’incendie
1. 
La raideur des personnages et les lignes verticales font écho à la voix off du générique, énergique et ferme. Tout cela sous-tend la loi, l’autorité sinon l’autoritarisme. En même temps, les éléments du décor comme un jeu de construction, le rouge vif du camion de pompier comme un jouet d’enfant donnent à l’ouverture de ce film d’anticipation un air de conte pour enfants. Arrivés dans l’appartement d’un jeune homme qu’un mystérieux coup de téléphone a mis en fuite, les pompiers entreprennent une fouille sous la conduite énergique de Montag
2. 
- Étrange, pas de lance, ni d’équipement contre le feu. Le silence des hommes en noir et la vivacité de leurs gestes (signe d’autorité) inquiètent de plus en plus. Que cherchent-ils ? Sont-ce vraiment des pompiers pour agir de la sorte ? Le dispositif de cette séquence repose entièrement sur une succession d’interrogations comme autant de petits moments de suspense. Montag découvre un livre dans le lustre
3. 
- Un mélange de perplexité et d’interrogation s’empare alors du spectateur. Pourquoi un exemplaire de Don Quichotte suscite-t-il autant d’efforts ? D’autres ouvrages sont bientôt découverts alors que le montage s’emballe : un placard, un four, un poste de télévision... Clin d’œil ironique : les livres semblent avoir dévoré les entrailles de la télévision. Une suite de plans sur des livres maniés avec rudesse et jetés les uns sur les autres traduit tout le mépris d’une société totalitaire envers son patrimoine culturel. Les pompiers de l’étage balancent le sac de nylon contenant les objets du délit
4. 
- La très forte contre-plongée rend le geste extrêmement impressionnant. Mais alors que l’on s’attend à voir le sac choir lourdement, c’est avec une extrême douceur qu’il s’envole dans les airs. Il semble même planer grâce à la magie du ralenti. L’artifice crée non seulement une tension dramatique en retardant le moment de la chute (nous allons bientôt connaître la raison de cette agitation), mais il dote surtout l’image d’une part d’irréalité qui la détache du reste de la séquence. Comme en apesanteur. Sa trajectoire, rendue grandiloquente par le ralenti, est comme un trait d’union entre deux univers, le nôtre aux référents connus que nous sommes en train de quitter définitivement (les pompiers éteignent les feux) et un monde aux codes inconnus dans lequel nous entrons (les pompiers dressent des bûchers de livres).
Les livres sont alors jetés par paquets sur un trépied. Pendant ce temps, un jeu triangulaire de regards se noue entre un pompier (Fabian), un homme et son fils qui ramasse un ouvrage. L’homme, dépossédé de sa liberté d’agir et de son pouvoir paternel, retire l’objet des mains de son enfant sous l’œil vigilant du pompier. En fait, les pompiers, représentants d’un pouvoir omnipotent et tyrannique, sont devenus les pères de la nation. Ils sont les gardiens d’un temple/dieu audiovisuel auquel les fidèles, hommes et femmes, rendent un culte aveugle. Après s’être paré d’une combinaison, d’un casque et de gants en amiante « comme un évêque », note Truffaut dans son Journal du film, le très prometteur Montag procède au sacrifice des livres après s’être emparé d’un lance-flammes en lieu et place d’une lance à incendie. Le feu tient lieu de seul discours apologétique
5. 
- Le scandale de la barbarie est tout entier inscrit dans ce plan aux silhouettes figées, silencieuses, fantomales. Seule la flamme – vivante – bouge. Tout est gris autour (est-ce là l’image d’un monde sans livres ? Un monde froid et aseptisé qui n’est pas sans nous rappeler quelques grands ensembles). Aucun mot de protestation, il n’y a que la fumée qui s’élève dans les airs. La démission de l’esprit est totale. C’est le feu de joie de la dictature et de la bêtise. Truffaut joue ici l’image pour le discours. Il croit fermement en sa puissance critique. « Il suffit, affirme-t-il, de montrer un livre qui brûle pour le faire aimer. Je n’ai pas voulu mettre une seule phrase en faveur des livres si bien que cela m’a permis de faire un film sans discours. »
Inventer des héros
Big Brother, en certaines circonstances, consacrait son ordre du jour à la glorification de quelque humble et simple soldat, membre du Parti, dont la vie aussi bien que la mort offrait un exemple digne d’être suivi. Cette fois, Big Brother glorifierait le camarade Ogilvy. À la vérité, il n’y avait pas de camarade Ogilvy, mais quelques lignes imprimées et deux photographies maquillées l’amèneraient à exister.
Winston réfléchit un moment, puis rapprocha de lui le phonoscript et se mit à dicter dans le style familier à Big Brother. Un style à la fois militaire et pédant, facile à imiter à cause de l’habitude de Big Brother de poser des questions et d’y répondre tout de suite. (« Quelle leçon pouvons-nous tirer de ce fait, camarades? La leçon... qui est aussi un des principes fondamentaux de l’Angsoc... que... » et ainsi de suite.)
À trois ans, le camarade Ogilvy refusait tous les jouets. Il n’acceptait qu’un tambour, une mitraillette et un hélicoptère en miniature. À six ans, une année à l’avance, par une dispense toute spéciale, il rejoignait les Espions. À neuf, il était chef de groupe. À onze, il dénonçait son oncle à la Police de la Pensée. Il avait entendu une conversation dont les tendances lui avaient paru criminelles. À dix-sept ans, il était moniteur d’une section de la Ligue Anti-Sexe des Juniors. À dix-neuf ans, il inventait une grenade à main qui était adoptée par le ministère de la Paix. Au premier essai, cette grenade tuait d’un coup trente prisonniers eurasiens. À vingt-trois ans, il était tué en service commandé. Poursuivi par des chasseurs ennemis, alors qu’il survolait l’océan Indien avec d’importantes dépêches, il s’était lesté de sa mitrailleuse, et il avait sauté, avec les dépêches et tout, de l’hélicoptère dans l’eau profonde.
C’était une fin, disait Big Brother, qu’il était impossible de contempler sans un sentiment d’envie. Big Brother ajoutait quelques remarques sur la pureté et la rectitude de la vie du camarade Ogilvy. Il avait renoncé à tout alcool, même au vin et à la bière. Il ne fumait pas. Il ne prenait aucune heure de récréation, sauf celle qu’il passait chaque jour au gymnase. Il avait fait vœu de célibat. Le mariage et le soin d’une famille étaient, pensait-il, incompatibles avec un dévouement de vingt-quatre heures par jour au devoir. Il n’avait comme sujet de conversation que les principes de l’Angsoc. Rien dans la vie ne l’intéressait que la défaite de l’armée eurasienne et la chasse aux espions, aux saboteurs, aux criminels par la pensée, aux traîtres en général.
Winston débattit s’il accorderait au camarade Ogilvy l’ordre du Mérite Insigne. Il décida que non, à cause du supplémentaire renvoi aux références que cette récompense aurait entraîné.
Il regarda une fois encore son rival de la cabine d’en face. Quelque chose lui disait que certainement Tillotson était occupé à la même besogne que lui. Il n’y avait aucun moyen de savoir qu’elle rédaction serait finalement adoptée, mais il avait la conviction profonde que ce serait la sienne. Le camarade Ogilvy, inexistant une heure plus tôt, était maintenant une réalité. Une étrange idée frappa Winston. On pouvait créer des morts, mais il était impossible de créer des vivants. Le camarade Ogilvy, qui n’avait jamais existé dans le présent, existait maintenant dans le passé, et quand la falsification serait oubliée, son existence aurait autant d’authenticité, autant d’évidence que celle de Charlemagne ou de Jules César
Inventer des symboles
Etude du Gouvernement de Vichy
- Relevez le vocabulaire employé pour mettre en avant la personne du Maréchal.
- Qu'en concluez vous ?
- Quels symboles porte l'histoire de Jeanne d'Arc ? Montrez comment Vichy récupère ces symboles à son profit.
- A quelles tranches d'âge s'adressent plus particulièrement ces commémorations ? Pourquoi ?
- A qui s'adresse en particulier le 1er mai, est-ce la portée traditionnelle de cette fête ?
- Expliquez pourquoi ce changement en insistant sur la vente des broches à l'effigie du Maréchal au profit du secours national
[Ressource n°5908 de nature non encore affichable]
Etude d'un texte de Paul Ricoeur définissant les trois niveaux de sens de l'idéologie. Cliquer
L'Art au service de l'idéologie
▶ Voir la vidéo d'Hannah Arendt
- En quel sens et pourquoi peut-on affirmer que la politique se fixe naturellement des objectifs « illimités » ?
- En quel sens le libéralisme prescrit-il une manière de penser le politique qui limite ses objectifs ?
- Que peut-on comprendre de l'affirmation d'Hannah Arendt selon laquelle sa philosophie politique ne peut se résumer à un terme en « isme » ? Quel est l'enjeu d'une telle possibilité ?
- Comment interpréter la citation de René Char selon laquelle « notre héritage n'est précédé [garanti] par aucun testament » ?
- En quoi la liberté de l'exercice de la pensée peut-elle être source de crainte, ou d'effroi ?
- La liberté dans l'exercice de la pensée est-elle limitée à certains hommes selon Arendt ? En quoi consiste-t-elle précisément ?
- Pourquoi la liberté de la réflexion politique ne constitue-t-elle pas un danger politique selon Hannah Arendt ?